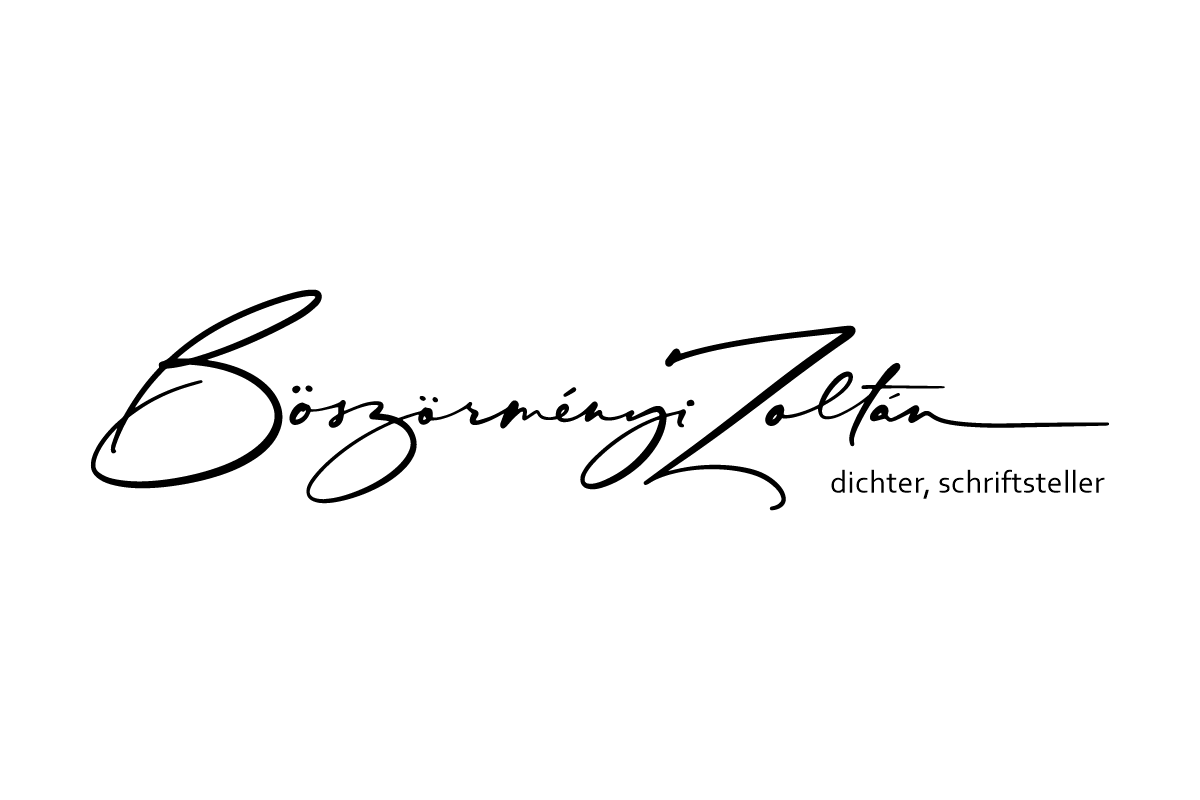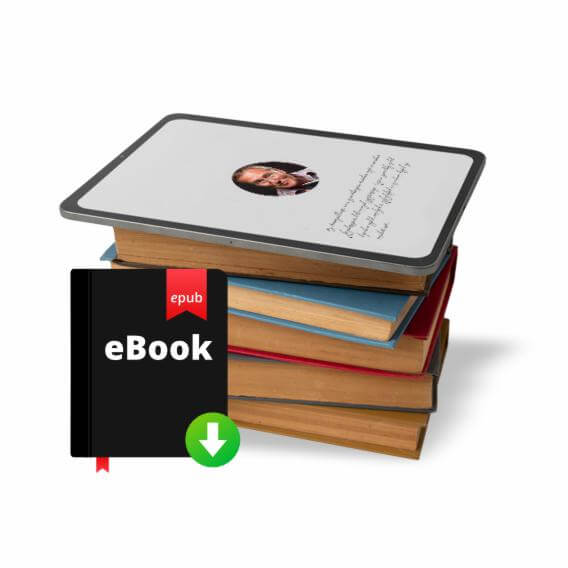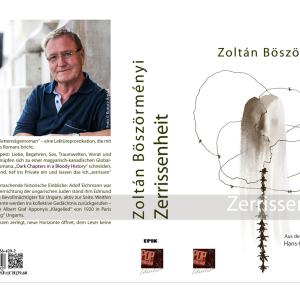Mirage de notre sort
Parlant tantôt de politique, tantôt d’amour ou d’esthétique, mais avant tout de la condition humaine et du mystère de l’être, la poésie de Zoltán Böszörményi a la langue bien pendue, ne se réfugiant jamais dans des formalismes prudents. Elle prend tantôt la forme de sonnets et autres formes fixes qu’il maîtrise avec un art consommé, devenu rare de nos jours, tantôt celle de poèmes en vers libres traversés par un ample souffle prophétique. Grand voyageur et grand lecteur, il nous balade de Moscou à San-Francisco, et convie dans ses poèmes les grandes voix avec lesquelles son destin poétique l’oblige à dialoguer : Attila József, Dylan Thomas, Pétrarque, Celan, Pessoa… Le présent recueil propose une anthologie représentative de toute la diversité de cette œuvre poétique hors-norme, à la fois hongroise et cosmopolite, classique et post-moderne, contemplative et polémique.
Ci-dessous, 17 des poèmes de ce recueil, dans la traduction de Raoul Weiss.
FAIRE INTERMINABLEMENT L’AMOUR
je n’éprouve que dégoût pour la corruption perfide
qui saoule, tue, ruine et abrutit
je veux une corruption pleine d’audace, pleine d’esprit
éveilleuse des plus nobles pensées
qui ait de l’imagination
qui pareille à l’incendie
dévaste tout
pour que tout puisse être reconstruit
que la concentration des forces positives
ne puisse rien contre elle
(la justice est d’ailleurs un acte intellectuel, et non sentimental)
qu’elle soit nerveuse, enthousiaste, urbaine
qu’elle fasse fleurir la république
qu’elle se passe de raisons, de tiédeurs, de chimères
qu’elle soit brillante, éblouissante, emportant tout sur son passage
comme la crue d’un fleuve en Amérique du Sud
aphoristique, mais indiscrète et démasquante
que Dalila jamais ne brise la force de Samson
que la lecture de Cicéron soit impunie
qu’elle se fasse volupté et qu’elle n’ait point de fin
qu’elle nous fasse interminablement l’amour
qu’elle soit Eros
l’étalage du spectacle
désir impitoyable foulant le seuil du songe
désert fertile plante carnivore
réalité torride inverse de la tyrannie
égarement historique absolu
qu’elle nous rappelle Tacite, Rome et Jérusalem
Aristote et l’histoire universelle
qu’elle chérisse Machiavel et l’excitante perversité
qu’elle adore Kant, que sa logique jamais ne rapetisse
la corruption – qu’elle soit sentimentale, avenante
de toute fronde qu’elle soit le plus vulgaire factieux
le fauve des fauves
qu’elle persécute l’indifférence
qu’elle soit ce point certain qui sort le monde de ses gonds
(car à quoi bon l’incertitude ?)
AURORE MARINE AVEC HEIDEGGER
En souvenir de Sándor Kilin
Ebruite l’aurore,
que le cœur de la mer sursaute de frayeur,
repousse un peu le disque du Soleil,
fais-toi de la place à ses côtés
(rangée de constructions plus ou moins provisoires).
Des paroles furent écrites,
des ponts, de berge à berge, suspendus.
Ton sourire en éclaire le sens.
Une feuille perd l’équilibre,
tombe,
un espace-temps épie sa chute.
Voilà tout ce que nous sommes :
des froissures de l’infini –
des sans-cuirasses !
Contrées respirantes
T’en es-tu rendu compte ? –
le corps est un terrain travaillé par le rêve de la terre,
et à chaque fois que tu éprouves
le chuchotement d’arbres songeurs dans l’hiver de cristal,
la caresse du dard de l’été,
tu sens
que l’amour se fait fleuve,
qu’il arrose ton pays natal, ses contrées respirantes
et que du grain semé
s’élève un épi de vie
dans le giron des aubes qui glorieusement tanguent.
FRANCESCO PETRARCA
Ma patrie, ce ne sont pas les collines d’Arqua
J’y reste un étranger comme en toute autre terre.
Mon pauvre père voulait que j’étudie le droit :
Je n’ai lu que Virgile, Cicéron, prose et vers.
Avant que d’enfouir mon cœur dans cette lumière,
Hanté par bien des anges et par plus d’un démon,
J’ai survécu à Florence et à Avignon,
Et du sonnet pourtant je ne suis pas le père.
Sachant l’histoire avant qu’elle ne s’accomplisse
Et les mètres latins qui sous ma langue se cousent,
Le regard de ma Laure m’accompagne complice
Jusqu’au pays sans vieux ni jeunes, et tout au bout
De mon destin tressé dans le destin d’Ulysse
Par ciel serein je brille au-dessus de Padoue.
EN CARESSANT
Une tendre brise sert d’édredon aux fleurs de ce matin,
pétales de jasmin, de verveine, de pensées,
doigts de mains au repos sur la table de nos joies.
Ce matinal enchantement est une bourse des sensations,
il exige un savoir de céleste artisan
à qui veut en son sein mesurer le poids du secret,
de la patience, de l’extase et de l’attente.
Le long des raidillons de l’âme, le chardon du réel pique,
tel est le sentier que j’arpente avec toi.
En aval, un écho vagabonde : c’est le message des arbres.
La rêverie – soie dorée – flotte au vent devant nous,
obsessives symétries du désir, pigeonniers du fantasme.
nous agrippant aux voiles d’un même mirage,
qu’enfle le vent d’une volage harmonie,
nous enfonçons à deux dans la broussaille
le calice de l’amour physique.
L’univers se mélange à l’impatient désir,
avant que les choses, encore et encore,
ne nous rejettent dans la jungle du quotidien.
Apprend, mon amour, que la bonté en avalanche peut être insupportable,
autant que la malice, la tromperie, le mensonge,
l’alarmisme démesuré,
et pourtant rien n’est plus humble que la bonté.
Une goutte de pluie s’amuse au bout d’une branche de l’arbre qui nous fait face.
Je scrute tes yeux à travers un grillage de lumière,
comme si je vivais désormais en toi, et toi toute entière en moi.
Sous nos têtes, un amène oreiller de parfums.
Les ténèbres de l’infini nous bercent dans leurs bras,
alors que nous préférerions ceux du scintillement.
Une coulée de la lave de ton ventre me brûle
la langue tandis qu’en moi quelqu’un chuchote
que jamais plus je ne devrais te laisser me quitter.
A KOLOJVAR LE SOUVENIR
Pour le 85ième anniversaire d’Alexandre Kányádi
Je tends le bras et la vue porte
jusqu’aux limites de la mémoire,
je vois l’oubli de soi
dans la danse rouge et noire.
L’écarlate solitude revient
s’emparer de mon cœur,
où elle souffle et étreint
les plus noires des langueurs.
Quelque doute qu’on ait eu,
jamais on ne l’oublie ;
de nos joies tout au plus
restera le débris.
Bande de garçons, filles de leur âge,
roses écarlates et fleurs sauvages.
Muets, main dans la main, au crépuscule têtu,
leurs regards lumineux s’étreignent à l’imprévu,
sur leur bouche saigne et meurt un rayon du couchant,
la lune monte et cabre tous les chevaux du vent.
Filles du même âge, bande de garçons,
Au grand feu de la vie, flammes à foison.
Les garçons tout en noir, et tendus comme un nerf,
les filles ont sur les joues une rouge lumière.
Le Szamos coule entre ses rives muettes, hostiles.
Un souvenir, au-dessus de ses flots frisés, file.
Le reflet d’astres austères
y propage une senteur aigre.
Comme si cette danse était la toute première,
et comme si rien ne leur était plus cher,
bande de garçons, filles de leur âge,
roses écarlates et fleurs sauvages.
L’écarlate solitude revient
s’emparer de mon cœur,
où elle souffle et étreint
les plus noires des langueurs.
je vois l’oubli de soi
dans la danse rouge et noire.
Je tends le bras et la vue porte
jusqu’aux limites de la mémoire.
MATIN A SAN FRANCISCO
Retourne-toi vers ce jour-là,
Fonds l’Acropole de la lumière en un secret,
fais tinter le châssis du temps,
une meute de rêves a pris son vol, échappe à ton toucher,
l’adolescent brouillard tremble devant tes muscles.
Le matin, traînée rougeâtre,
galope, s’évanouit devant tes pas,
il a peur
de se faire marcher dessus,
ton humeur et ta compréhension du monde
ayant – cela reste entre nous – la gueule de bois.
La pourpre du Golden Gate dissout
ses cellules d’acier dans l’océan,
et de son mât fiché dans le gris d’un nuage
lacère les entrailles de l’ennui.
Le paysage se déshabille.
Où que tu regardes,
entre les immeubles endimanchés
des automobiles,
ces poissons métalliques projetés sur la rive,
un printemps rôde, étincelant.
Sur le trottoir, quelques pas devant toi,
le vent de service passe son balai.
De retour à l’hôtel,
au frais sous les arcades,
monologue en sourdine sur les lèvres des hôtes,
devant l’ascenseur un gosse trépigne.
Sésame ouvre-toi,
Néon jette un éclair,
l’atmosphère est ici si différente :
chemise de ouate.
La paix du corridor tressaute,
sur les murs, en noir et blanc,
des photos d’époque,
les larcins de la nature :
immeubles effondrés sur leur douleur
en mille neuf-cent six,
un regard, et la terre à nouveau tremble.
En entrant dans la chambre,
tu recherches la clé du futur,
hier encore, elle y était :
tout au fond de la poche de la veste pendue au dossier du fauteuil,
sous-marin immergé au fond de la mystique,
plongé dans la vision,
submarine vagabond.
CATHEDRALE DE L’HIVER ETERNEL
A seize ans je ne voulais pas
sauver le monde, mais j’imaginais
une sorte de révolution,
de quoi se défouler
(C’est bien là la moindre des fantaisies
d’un garnement au menton duveteux.)
La révolution, d’ailleurs, il n’y avait rien
de plus évident pour quiconque était né
dans la ville des treize martyrs, c’était pas
midi à quatorze heures :
descendre des poulies d’acier du lieu,
du milieu, de l’histoire, équivalait
à se mesurer aux grands anciens, à suivre
leur exemple jusque dans la mort héroïque : Damjanich,
Pöltenberg, Knézich en auraient dit de même.
Tout au plus feraient-ils remarquer :
« Faudrait trouver moyen de faire ça
plus intelligemment, fiston. »
Pouvais-je prendre en compte cet avertissement ?
Pouvait-il avoir alors la moindre signification ?
Je n’en sais plus rien. Ce que je sais,
c’est que les révolutions à base de mal du siècle
– collectives ou en single –
sont inutiles et méprisables.
Reste donc le verbe, bon à épingler sur de saints drapeaux,
le verbe dans lequel cent et mille fois déjà
s’est consumé tout l’univers.
Nul défi plus noble que de se consacrer
à une lutte éternelle, tout en devant
se préparer son bois de chauffe tous les matins,
et de songer, tout en fendant ses buches,
à ce que nous prépare l’avenir.
Le béton des murs de l’avenir laisse
moins de place aux récidivistes de l’évasion.
Pour échapper à tous vos ennuis,
enfoncez votre tête dans le sable,
ne vous occupez pas de ce qui se passe là-dehors,
ni de ce qui se passe là-dedans.
Le destin, quoi qu’on fasse, nous réserve un hiver long,
que votre obstination s’y creuse un tunnel,
si vous voulez rendre indéniable votre déni,
et rentable votre investissement.
Sur un tel fond, la main déjà presque blanche a bonne mine,
et personne ne se plaint des conclusions tardives,
d’avoir perdu instant après instant,
des hauts et des bas de la cinquième saison,
de voir chaque nuit bien trop
facilement s’y dissoudre.
Tous vous aideront à avoir froid.
Mais ce qu’il y a d’inoubliable, ce sont les grands idéaux
et leurs chaises musicales : synode par-ci, cinoche par-là.
Le reste est réaction épidermique.
L’univers devient invisible, la respiration
s’accélère, on perd, aussi, plus facilement,
une fois emboué, qui peut bien se souvenir
comment ça s’est passé – et quoi ?
Un habit neuf jaillit de l’armoire,
miraculeux changement, les racines, à quoi bon,
elles s’étiolent en dernière analyse.
L’esprit se cherche des prétextes,
vérifions le cours de la sincérité :
telle un joyau d’antiquaire,
elle décorera mon living-room.
Que de cadeaux dans cette débauche,
et combien de malentendus !
Le long des lignes brisées, l’attention s’égare,
la pensée glisse et se déconcentre,
et demain restera égal à demain,
que d’aucuns se retrouvent – ou pas – bloqués dehors.
Le sort des petits poissons manque de tragique,
dans la grande procession, il tourne vite au détail.
Engendrée par la nuit la plus dense,
la peur grandit sous le manteau des brumes,
elle est déjà si grande que j’en oublierai vite
de qui j’ai conservé le verbe.
J’ai fait la course avec tous ces automnes.
Sur la planche de départ, d’abord, il n’y avait qu’eux,
puis mon tour est venu.
Le stock d’amok s’est épuisé.
Les jours étaient pâles, anémiques,
les nuits tuberculeuses,
j’y ajoutais un jeûne de mots,
et parfois, dans leur gêne, les arbres bordant
la route me tenaient des discours d’ivrognes.
Je prenais les avions pour des grues,
et j’attendais de m’envoler avec l’une d’elles.
A Világos
ça devient moche
équation muette
on a pris perpète
de chaque fait
je reste prisonnier
On a fait reluire
le dessus de la table,
mais qui s’en souvient,
les eaux du temps ont emporté
la chaise, le chapeau,
et depuis lors, sans cesse
nous chiffonnons la honte,
et mitonnons
un genre de nostalgie,
qui nous mitonne,
et l’histoire tremble avec nous,
dans son uniforme métallique
plein de marques au poinçon.
Görgei le Grand
nous a mis là-dedans
La patrie est perdue,
le bruit des batailles s’est tu,
reste l’honneur et rien de plus,
et depuis lors, il neige, énormément.
Ame hongroise immergée dans l’éternel hiver,
je te vois encore bien et t’espère,
les couteaux bien coupants
restent vifs dans mon cœur,
je construis pour l’hiver éternel une cathédrale.
Comme on cache dans l’hiver ses trésors,
oublieux de sa voix, de sa mine, de son visage,
c’est en vain qu’on tire les cheveux de l’âge,
en vain qu’on ravale ses cris d’alerte,
on encaisse en pure perte :
attendre des jours meilleurs ? – très peu pour moi.
Je vous lègue donc la cathédrale de l’hiver éternel.
LE ROND-POINT FAIT PARTIE DE L’IMAGE
Il y a soixante ans de cela.
En souvenirs des morts de 1956.
A travers les nuages, l’éclat criard du sang,
sur tes cheveux la lumière pâle des lampes à arc.
Le rond-point fait partie de cette image, avec
les bûchers qui l’entourent. Une porte, au second plan,
conduit dans les recoins brumeux du temps jadis,
derrière le voile du soir, une angoisse tremble encore.
Des murailles de parfum tombent et t’ensevelissent,
dans la broussaille aride rampe un vent plein de peur.
Le temps pousse un grand cri, le temps s’enfuit pieds nus
devant les flammes d’octobre, feux d’armées invaincues.
Où l’on vit choir un jour de si rouges étoiles,
ta parole ouvre les fenêtres et sur l’autel
une fleur nous sanctifie. Ô toi, réalité
vivante, le lourd habit de la mémoire te sied.
TRAINS VIDES
C’est sans toi qu’ils partent,
et sans toi qu’ils arrivent, les matins.
Vides comme des trains.
Dans l’agonie luminescente de l’horizon
tu vis encore parfois une fulgurance d’envie,
des entrelacs de souvenirs dans un miroir muet.
Un brouillard de phrases s’élève
sur les pentes de paysages désuets,
elles fixent le néant,
déjà bien fatiguées.
Les acacias ont reconquis les berges du fleuve,
la tempête de l’automne n’en a blessé que peu,
silencieusement soignés par des vents délicats.
Cette nuit les voisins n’ont pas
percé les murs,
la chambre abandonnée, le lit vide, et au-dedans,
le calice de l’amour laissé béant,
sur l’oreiller de bois polychrome qui froidit,
le frémissement du rêve d’une époque éloignée,
la joie pourrait rentrer en catimini,
mais il n’y a plus personne pour la mener à gué.
LUMIÈRE NOIRE
Hommage à Paul Celan
sombre lumière du verbe
sombre esprit scintillant
les sombres fleurs du givre
incinérées dans la splendeur
le soleil parcourt sombrement le ciel
tout ceci n’est que danse d’éclairs noirs
et la boite noire de tes aveux
dans l’épaisseur sombre du temps
des montagnes s’égarent
du haut des arbres bruissent
de sombres feuilles
de noirs panneaux
d’intersection
te menacent sombrement suspendus
au plafond de ta sombre mansarde
le châssis des fenêtres est tout noir
à l’aveuglette les pensées vont
et viennent en toi
survolant ton logis de papier
lignes noires
nuages de suie
ECLATS DE LUMIERE
Et voici que s’envole l’armée des papillons.
L’espace d’une seule respiration.
Les schémas récurrents. Peut-être le péché.
Par ses taches translucides perce la fièvre qui couvait.
Sa membrane est visqueuse, se disloque comme du tulle.
Son odorant vernis colle au matin plein de lumière.
Pas de blague, ni aucune confession malvenue.
Aucune frontière.
Le mutisme et l’excitation : mille et mille rainures,
et personne pour t’y suivre.
Sur une branche maigrelette, un oiseau de rien du tout.
Son bec béant, ses yeux : des éclats de lumière.
Il cherche à se poser – mais où ?
Il va s’asseoir, ce siècle plein d’arrogance,
Il va s’asseoir et puis te réduire au silence.
MON ETRE DE POUSSIERE
Le sentiment du manque me pousse à de grandes œuvres
Nid de corbeau, je couve l’œuf d’un verbe féroce.
Dans la faiblesse gît une plénitude de force :
Endormie – elle s’éveille dans l’acte créateur.
Seul le manque est fécond. J’ai vu la flamme au vent
S’éteindre, j’ai vu ramper la lave d’aucun volcan.
La lumière, déité vorace, est une idole.
Même l’invisible foi a l’esprit d’une personne.
L’univers est ce vide qui m’a fait être moi,
Et tout le temps des steppes pèse sur mes genoux las.
Sur moi, l’œil du néant, enfant prodigue, brille,
Je suis triomphe et chute, nuage qui se dissipe.
Jalousement le rien me garde d’une main de fer
Et l’océan disperse mon être de poussière.
NEUF OCTAVES
Sur les lambeaux de l’âme la braise des mots s’empile,
Morne magie des troupes sur de mornes chemins,
Cocaïne répandue sur la toile du réel.
Mille voiles dans le giron du vent filent vers leur fin,
Sur le tertre fumant de l’imagination,
Rite antique, une vision torturante va et vient.
La pensée chauffe et sur sa dense végétation
Des lumières font tourner la table du vouloir
A neuf octaves de profondeur par partition.
C’est sans issue : révolté hier, aujourd’hui mort.
Poignée de cendres que les hivers dilapident,
Nul ne revient payer au siècle son pourboire.
Les pâtures de l’amour finissent en monts arides,
Qui t’a tendu un rêve, celui-là, qu’il te guette,
Dans l’exil démuni, aux confins intrépides.
La bouche cherche à tâtons des mots et trouve le ciel,
Les Crésus d’aujourd’hui se sont couverts d’oubli,
Le présent ne sait plus ce que l’avenir savait.
Le gel scintille d’un feu nouveau jusqu’au zénith
Et le bon peuple acclame un Prométhée de plus,
Mais il laisse sur la peau du temps sa plainte écrite.
L’air tremble car la dent des flammes dévorera
Toute chose, mais il devra se taire, celui qu’un jour
Une fièvre a mordu, que l’on appelle Héra.
Il montre les montagnes, prie Dieu – le dieu d’amour –
De revivre toute chose, de tout recommencer,
A bord d’un navire neuf, repartir pour un tour.
Repartir pour un tour, pouvoir tout repenser,
Tout ce qu’enserre et lie la chaîne des millénaires
Dans le ventre du temps – ventre que nul, jamais,
Ne fera avorter. La force qui toujours
Nous pousse, la toute-puissante, qui nous hante et arbore
Des armes sans âges sur son blason de velours.
Emergeant peu à peu d’un épais brouillard d’ombres,
Un fantôme apparaît – à ses côtés, la peur,
Berger chenu, divague : c’est le spectre de l’ordre.
Prince et pape des mutins et des esprits frondeurs,
Reflet terrestre en toi des cieux infléchissables,
Génie quintessencié d’un été de malheur,
Amant du vent perdu sur la blondeur du sable,
Celui dont rien ne saurait plus changer le sort,
Il l’enterre en soi-même au plus profond de l’âme.
Créateur du besoin, aujourd’hui et encore,
Son poignard, sa parole s’attaquent à ce qui fut,
Même la vision vertigineuse a son bras mort.
Le soleil perce au loin, l’attendant bras tendus.
Lui rêve d’envol, la tendresse brille sur ses ailes,
Et surgissant blessé de l’abîme, qu’a-t-il vu ?
Sur les lambeaux de l’âme la braise des mots s’empile,
Morne magie des troupes sur de mornes chemins,
Cocaïne répandue sur la toile du réel.
MIRAGE DE NOTRE SORT
Les poètes, ô mon Prince, sont morts jusqu’au dernier !
Au fond du labyrinthe de la lumière leur trace
Est encore bien visible. Eux jamais ne trichaient,
Leur seul crime fut de se lasser des lois d'Horace.
Leur chant n'est plus là pour dire la grandeur de Rome.
Nous leur devons l’hommage d’une sublime prière,
Car la couronne de myrte sied à leur front fantôme :
Leur âme errante est le mirage de notre sort.
Il ne tenait qu'à eux de vivre encore ici,
D’humeur mélancolique, sous le pampre éternel,
Là où fume le bûcher des roses évanouies,
Où l’inspiration fuse, la sagesse étincelle,
Tissant de nouveaux contes, mutato nomine
de te fabula narratur, courant encore
Après la gloire qu'agite le vent devant leur nez :
Leur âme errante est le mirage de notre sort.
Rome – Rome même – n'a plus voulu de leurs couplets :
Ridentem dicere verum quid vetat ?
Le bon sens ne s'enivre que de vérité,
Le temps passe devant leur sérail sans plus faire halte.
Dans cette moderne solitude l’éternel cirque
Des étoiles folles souffre du manque de leur clameur –
Pourtant, point de disette de l’opium poétique :
Leur âme errante est le mirage de notre sort.
Envoi :
Mais que quiconque ravive cette flamme du dedans
Et le poème enfin connaîtra son âge d'or.
Vos voiles, poètes, se gonfleront soudain de vent :
D’une âme exubérante, mirage de notre sort.
INVENTAIRE
“Inventaire clos.” Rien ne va plus. Blanc de linceul.
Mise après mise. Croupier de l'hiver éternel.
Au violon, deux sauterelles.
Dans la cuisine, la marmite vide sent le roussi.
Livres, picole, passage à vide, bleu de l'oubli.
Ville pleine de boue à sa sortie.
Ma chemise repassée, si tu la veux, je te la donne.
Tes doutes, je vais les apaiser avant demain.
Toi mon trésor. Mon tout. Mon rien.
Un atome.