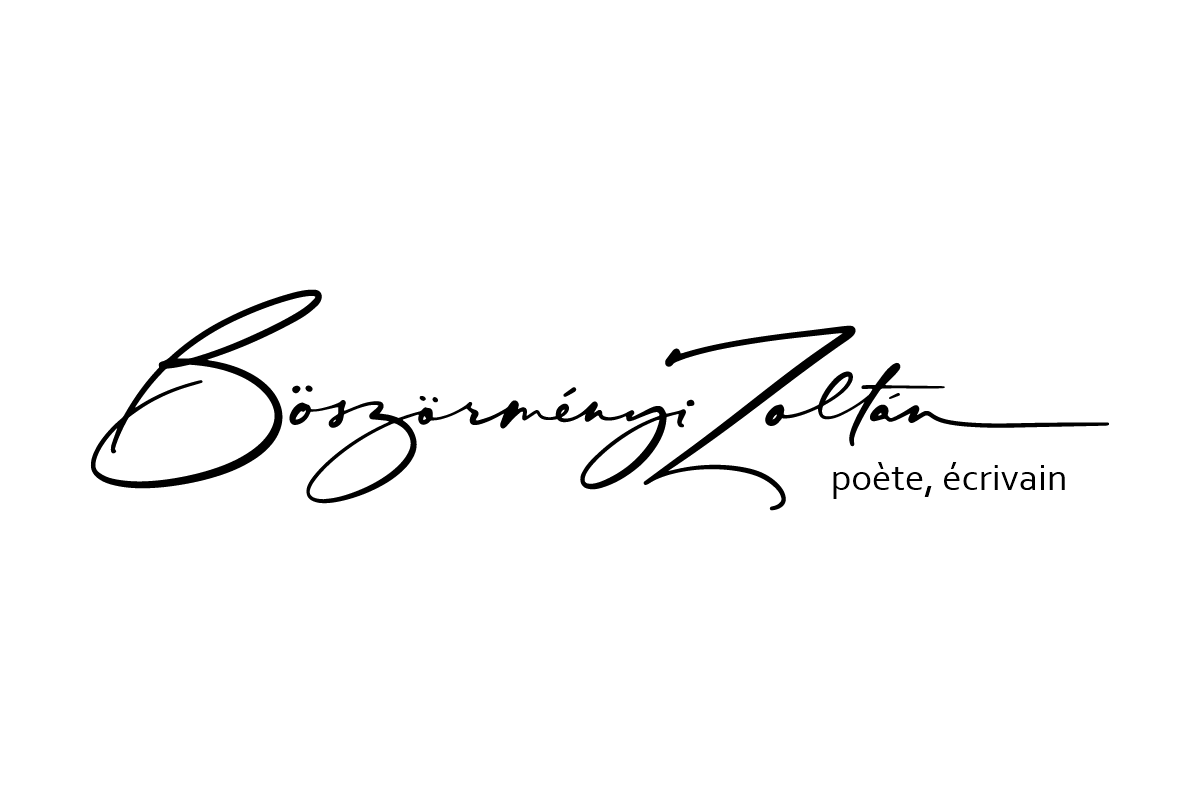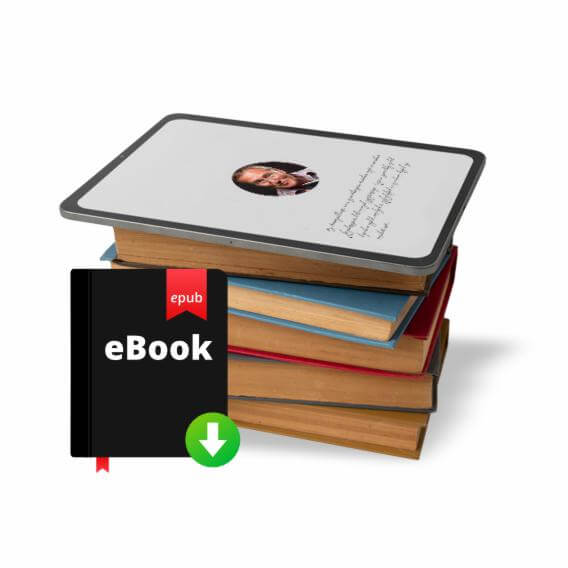Intimissimi
Intimissimi
Nous mentons si joliment au monde,
et à nous-mêmes, mais convaincus, du fond du cœur !
La réalité nous prend sur le fait, et nous arme :
la plaie mutante, imaginaire, pompe des volts par milliers dans nos veines.
On approche de nous les lampes de Diogène.
Voyons l’obscurité, que la lumière lave nos moroses pensées,
qu’elle les frotte jusqu’à les blanchir !
Opération « plus blanc que blanc » !
Voir l’arbre dans la forêt. Le combustible !
Quant à l’âme, qu’elle se fasse, si elle veut, des idées !
Elle n’en saura pas davantage courir au-devant du futur.
Le futur, c’est nous – c’est en nous qu’est l’avenir, le néant,
les efforts, les moqueries de ceux qui nous bafouent,
l’être réduit à rien : gloire et tragédie des trompés.
Le fanatisme nous élève.
(Nous fait de l’œil, pour peu qu’on se pointe à temps.)
La génération Facebook s’active, mobilise, interpelle :
« Venez manifester contre le gouvernement à quatre heures cet après-midi,
et vous gagnerez cinq mille forints. Réclamez votre cadeau auprès de notre bureau ambulant !
De nos jours, l’enthousiasme ne paie plus – tout au plus, les huées.
Pas la peine d’apporter des sifflets. Nous en avons en grande quantité,
de première classe, testés, plein nos entrepôts.
(à l’époque d’Andropov, en France, ils ont fait leurs preuves.)
Au petit matin, nous en distribuons gratuitement. »
Fascination !
La société n’est pas une urne transformable en cendrier,
en cendrier et en poubelle – même Cendrars en était bien conscient
pendant ses errances russes. Les têtes obtuses
et les cœurs froids, de tous temps, se sont laissé leurrer.
L’indocilité, la résistance – voilà le grand cadeau du destin.
(Pourquoi s’étonner, tout au long de l’Histoire, des files d’attentes de millions d’hommes
le désirant ?
Les bonnes choses méritent toutes une file d’attente !)
Vita brevis !
Que l’aube pointe !
Pénétration !
Quel poison qu’une mauvaise ambiance !
Elle empoisonne les entrefaites, l’humeur,
sa mauvaise toxine imbibe
le système de nos sentiments.
A l’ombre des arbres, c’est autre chose !
(« Tant que je te guide, ne t’inquiète pas ! » – nous redit Virgile.)
Ô Vérité, Janus Bifrons, où est-tu passée ?
Ne crains-tu pas le malentendu ?
Le malentendu fait aussi partie du style.
Léopold Bloom a tout cela :
mi-bas, délire fiévreux et chat
– il ne lui manque qu’une vie.
Car le pouvoir, quel qu’il soit, nous prend toujours quelque-chose :
tantôt l’envol, tantôt la certitude.
Debout, les yeux bandés, au bord du précipice :
De l’arrière, on nous crie : plus un pas !
Mais là-devant quelqu’un crie : viens !
Schumacher et le trophees du poete
Je collectionne les mots rares, les métaphores,
les parfums de villes,
comme Schumacher accumulait
ses voitures de course,
ses combinaisons, ses nombreux trophées.
La litanie mauve des attachements et des douleurs
de l’enfantement.
Car enfin, tout mène bien à l’unique,
à l’inimitable – à conserver l’instant,
le goût d’une course folle en bouche,
dans les légendes ?
Je collectionne des miettes d’instants universels,
des allégories d’élan, du sublime amour,
du tant espéré.
Elle bouge sur l’épaule de titans,
la réalité, altérée dans ses fondements,
pour me permettre de dire
les arabesques du champ magnétique,
la vérité de l’autre,
que mes prédécesseurs n’ont jamais proférée,
qu’on ne peut que lire dans le regard des phénomènes,
car, en règle générale, l’évidence particulière
ne parle pas d’elle-même,
mais elle est sûre,
elle est précise,
déterminante.
Seul le baiser te fait sentir ces goûts,
seul le désarroi de l’excitation,
seule la prière.
Même si tes mains sont dans les chaînes,
tant que ton imagination
laisse courir une pensée libre,
tu peux créer un monde nouveau,
de nouvelles bornes au luxe des mots,
une dimension,
une vision,
une lueur
pour ce battement d’ailes qui vient à ta rencontre.
Le rond-point fait partie de l’image
Il y a soixante ans de cela.
En souvenirs des morts de 1956.
A travers les nuages, l’éclat criard du sang,
sur tes cheveux la lumière pâle des lampes à arc.
Le rond-point fait partie de cette image, avec
les bûchers qui l’entourent. Une porte, au second plan,
conduit dans les recoins brumeux du temps jadis,
derrière le voile du soir, une angoisse tremble encore.
Des murailles de parfum tombent et t’ensevelissent,
dans la broussaille aride rampe un vent plein de peur.
Le temps pousse un grand cri, le temps s’enfuit pieds nus
devant les flammes d’octobre, feux d’armées invaincues.
Où l’on vit choir un jour de si rouges étoiles,
ta parole ouvre les fenêtres et sur l’autel
une fleur nous sanctifie. Ô toi, réalité
vivante, le lourd habit de la mémoire te sied.
Majorana sur la place Rouge de Moscou
une chose depuis des jours m’angoisse
et pourtant rien ne se passe
le chant s’installe à mes côtés,
venu de contrées lointaines, d’hivers impénitents
d’un printemps sans espoir
nous arrive l’âme à demi cuite
qui lorgne à ma fenêtre
il me faudrait ouvrir les portes
des places abasourdies et des secrets
inviter quelqu’un à se promener l’après-midi
sur la Place Rouge où le fantôme
sans repos de Pougatchev
trame une nouvelle révolution
l’ordre, maintenant, c’est ça
le nid des idéologies définitives est resté vide
divisé en trois camps, le peuple
espère une aube meilleure
quand il lève les yeux au ciel
et perce du regard l’oligarchie
L’argent, c’est le pouvoir fait capital
il a son organe sexuel
et sa vertu : anéantir,
créer (espoir sublime),
tout changer mais à quoi
peuvent s’attendre ceux qui
ont toujours attendu, et toujours en vain
la certitude de la présence
le tintement des cloches de Pâques
l’ange familier des liturgies
le mandala de l’idéal dans la bataille
la branche et son oiseau – deux orphelins
le col de cygne du désir inextinguible
les capillaires que la pensée a nettoyés
le mutisme en cascade
sur sa branche la lumière en accélération
la tempête caucasienne dans un paysage serein
le domestique muet du moi
voilà ce que vaut la volonté, rien de plus
imagination zéro
les parois de l’histoire quand on les cogne en chœur
le parfum de la chatte
veilles d’entre les congés
les miracles se produisent
adviennent
hordes tatares aux confins de la ville
c’est au tour de Roubliov
sur un vernis d’effroi déguisé en icône
le soleil scintille
ode à la joie
clairons
dans la cage d’escalier du temps, l’écho
de pas
les dimensions de l’existence
furoncle des péchés
chevaux débridés au miroir de la voûte céleste
retour des paradigmes
fétiches de l’expérience plein la charpente
blanc du crépis tombé des cheminées
dialogue avec des idées séchant sur une corde
quand on sonne
et qu’à la porte un inconnu
en chapeau noir
attend impatiemment
Trains vides
C’est sans toi qu’ils partent,
et sans toi qu’ils arrivent, les matins.
Vides comme des trains.
Dans l’agonie luminescente de l’horizon
tu vis encore parfois une fulgurance d’envie,
des entrelacs de souvenirs dans un miroir muet.
Un brouillard de phrases s’élève
sur les pentes de paysages désuets,
elles fixent le néant,
déjà bien fatiguées.
Les acacias ont reconquis les berges du fleuve,
la tempête de l’automne n’en a blessé que peu,
silencieusement soignés par des vents délicats.
Cette nuit les voisins n’ont pas
percé les murs,
la chambre abandonnée, le lit vide, et au-dedans,
le calice de l’amour laissé béant,
sur l’oreiller de bois polychrome qui froidit,
le frémissement du rêve d’une époque éloignée,
la joie pourrait rentrer en catimini,
mais il n’y a plus personne pour la mener à gué.