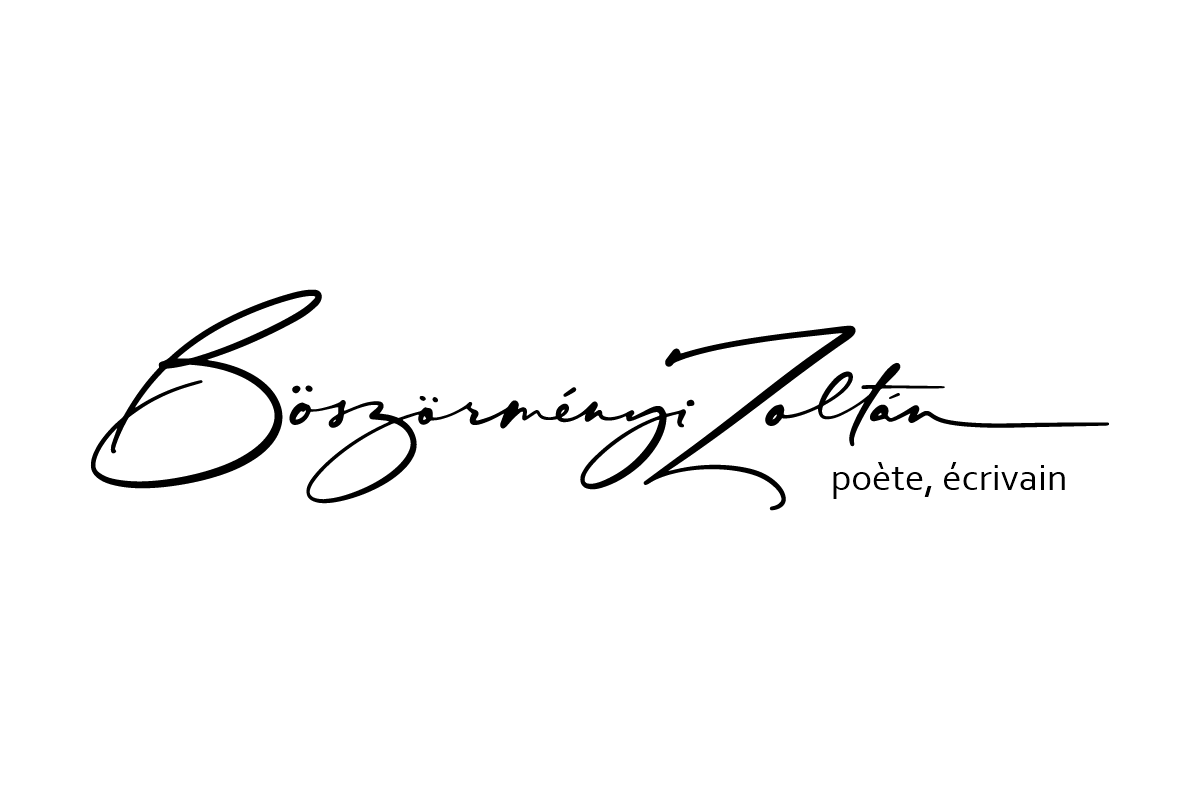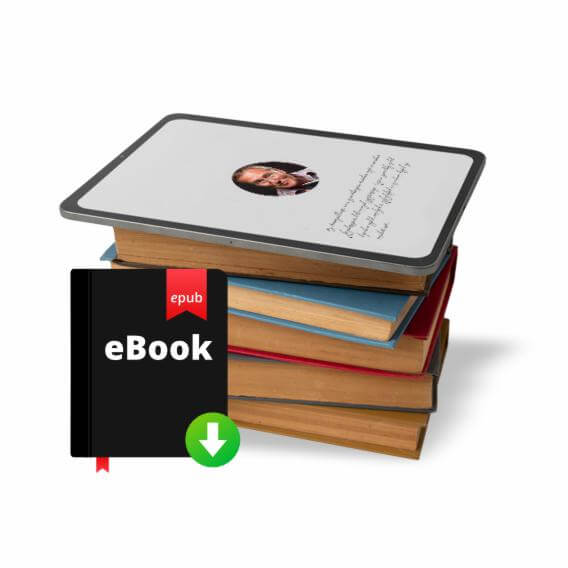L’unique feur du douanier
L’unique feur du douanier*
en souvenir d’Imre Kertész
Debout, tenant sa fleur, son unique, en main,
il est toujours à sa frontière, cet éternel douanier,
attendant l’arrivée du train suivant.
Il tarde, comme d’habitude,
le moment de la prise de conscience,
et les fleurs du printemps s’accumulent dans la chambre,
la mémoire fouille dans le feuillage de la vision,
das Ding an sich, trouvaille anthropologique
du legs de Königsberg,
par les meurtrières de l’esprit, l’être
a sa constante logique : le tout
se manifeste sous la forme d’une éternelle variable.
S’accumulent dans la chambre les fleurs du printemps,
et par les fentes des stores le soleil perce.
Seule l’œuvre peut encore faire preuve de conséquence,
car des rapports internes, désormais, qui se soucie ?
fendre les siècles ne nous apporte aucun repos
sous l’assaut conséquent de l’intranquillité.
Nous dressons des statues pour les héros de Sparte,
et partons voir, un soir, la pyramide de Chéops
(de son vrai nom : Khnoum-Khoufou Hor Medjedou,
dont on ne trouve mention crédible ni dans le papyrus
Westcar, ni chez Hérodote, ni dans les rouleaux de Manéthon,
l’histoire ayant pu être falsifiée dès cette époque),
non seulement pour jouir de cette vue fantastique,
mais aussi pour s’acoquiner
avec la nuit courbée sur ce paysage,
qui, sans se presser,
pareille à la tristesse de notre enfance,
l’un après l’autre,
nous couvre tous.
*Allusion au Procès Verbal d’Imre Kertész
Lettre de Toronto
à György Mandics, pour son 75ième anniversaire
Unus amicorum animus*
Aristote
C’est de Toronto, ossifié par le gel,
que je t’écris cette lettre.
Il y a quelques jours que je suis arrivé
dans cette métropole à moins vingt degrés
à laquelle me lient tant de souvenirs
et d’innombrables tempêtes de neige.
Cet endroit est pour moi ce que fut
Temechvar pour Bolyai :
des murailles nuageuses, mutinant l’altitude et le secret
entre des boulevard de solitude.
Cette ville désormais appartient à l’oubli,
ligotée dans la glace des avenues du gel.
Dans le miroir du lac Ontario
se perdent les lambeaux de sueurs d’étés anciens,
sous le joug de l’hiver, les troupes de la tension,
armées jusqu’aux dents, attendent
l’arrivée du bus de la pensée
au croisement des rues Bloor et Yonge.
Tu peux prendre cette ligne avec moi,
dans cette même ville
où Hemingway mima le journalisme
pour le compte du quotidien Toronto Star
entre mille neuf-cent vingt
et mille neuf-cent vingt-quatre.
Au club de la presse,
j’ai un jour retrouvé le registre des honoraires,
affiché sur un mur,
même si ce n’était qu’un facsimilé,
j’étais curieux de savoir
combien le futur prix Nobel américain
touchait pour ses articles.
Tu te dirais sûrement
que ces soixante-quinze dollars par semaine
ne devaient pas peser lourd à Paris,
dans la poche de celui qui fréquentait
Gertrude Stein, Pablo Picasso et Ezra Pound,
et tu tirerais la gueule, à l’idée que lui aussi
devait payer plein pot ses lumières à la ville-lumière.
„Paris is so very beautiful that it satisfies
something in you
that is always hungry in America.”
La faim du beau,
la faim des souvenirs saturés de trac,
conclurais-tu.
La dérive des désirs…
Ce sont, tu vois, des choses concrètes,
empiriques, aujourd’hui comme jadis,
qui peignent les aquarelles de la vie.
Des miniatures de minarets relaient l’écho
des attributs de Spinoza.
Au-dessus de nous s’attardent
les ombres d’atomes déliés
et dispersés aux quatre vents.
Le verbe,
déchiquetant les syllabes du sens,
nous parle avec douceur,
injectant patience
et ténacité dans nos veines.
Cela demande dignité, discipline et extase :
sans elles, comment créer des mondes,
comment laisser des cicatrices
au front de l’univers ?
Mon Dieu,
délie en nous
le nœud têtu des liens de la matière,
épargne-nous la laisse de l’imagination,
laisse-nous libres de prendre notre essor,
de traîner par les espaces vierges du néant-monde.
Que le plus fini de la finitude
soit la lueur de notre liberté,
la demeure, où nous ne pourrons vivre,
ni dessiner selon les lois
géométriques d’Euclide.
L’espace abstrait est aussi faillible que l’âme.
*Les amis n’ont qu’une âme
Ballade New-Yorkaise
Inspiré par un fait divers d’époque.
Par un matin d’automne particulièrement chaud et venteux,
sur le plancher de briques de la remise, John, onze ans,
joue au Monopoly avec Mary, sept ans.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
Un dé malchanceux fait que John
doit passer par la case prison.
Il proteste, indigné,
et veut relancer les dés.
Mary ne se laisse pas faire, et lorsqu’elle voit
que ses arguments n’ont aucune prise sur lui,
elle se met à trépigner.
Elle le traite de tous les noms, et John,
soudain, lui plante la fourche dans la poitrine.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
Dylan Thomas, poète gallois, après dix-huit
whiskys descendus l’un après l’autre,
sort, titubant, de la White Horse tavern de Greenwich Village,
et s’effondre après quelques pas.
Deux passants le relèvent, et le conduisent au Chelsea Hotel.
C’est le lendemain, à l’hôpital Saint-Vincent,
qu’il déménage dans l’autre monde.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
John prend la scie pendue à la paroi moisie de la remise.
Avec la scie, il coupe en morceaux le corps de Mary.
Il place les morceaux, un par un, dans des sacs de plastique noir,
avec de gros cailloux trouvés dans le jardin,
et plonge ces paquets dans l’Hudson.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
La White Horse tavern se trouve à New York,
au 567, rue de l’Hudson,
entre la 11ième rue et la rue Perry.
En entrant, à côté de celui du Cheval Blanc,
on voit le portrait de Dylan Thomas sur un mur,
et le garçon de comptoir vous apprend
que Norman Mailer, Allen Ginsberg, Jack Kerouac,
John Ashbery et Frank O'Hara sont aussi passés par là.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
Par un jour pluvieux de fin d’automne,
John joue au Monopoly avec Max, six ans,
entré par hasard – il passait par cette rue.
Un dé malchanceux fait que John
doit passer par la case prison.
Il veut relancer les dés.
Max proteste avec véhémence.
John lui plante la fourche dans la poitrine.
Il place les morceaux détachés à la scie
un à un dans des sacs de plastique noir.
Dans chacun, il ajoute un caillou
pris dans le jardin.
Il jette ces paquets dans l’Hudson.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
La White Horse tavern de Greenwich Village est vide.
Un panonceau pendu à la porte d’entrée :
Fermé pour cause de maladie
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
John se sent seul. Il sèche l’école depuis des jours.
Traînant dans la rue, il croise des garçons.
Ils gueulent à qui mieux-mieux,
se vantant de leurs espiègleries.
John, à son tour, raconte ce qu’il a fait de Mary et de Max.
Les couteaux acérés du soleil transpercent les interstices de la palissade.
Des scaphandriers ratissent l’Hudson.
Shall I unbolt or stay
Alone till the day I die
Unseen by stranger-eyes
In this white house?
Hands, hold you poison or grapes?*
*Dylan Thomas, « Ears in the Turrets Hear »
Promenade le long de L’arno
Anno Domini 1504. Trois artistes italiens vivent à Florence :
Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello – quant à Sandro Botticelli, il vit à côté de Florence, et passe souvent en ville.
L’après-midi venu, je marche le long de l’Arno,
les façades de Florence dans le miroir de l’eau,
comme des photographies collées les unes aux autres,
se cintrent à sa surface finement ondulée,
le fleuve poursuit son cours sans s’occuper de moi,
resplendissant et rajeuni dans le soleil.
Je vois Michelangelo qui se dépêche, accompagné
de son fidèle Ubrino,
cogitant peut-être un nouveau sonnet –
c’est à son amour, Tommaso Cavalieri,
qu’il écrit ses vers tout pleins des flammes de la passion,
mais le monde extérieur est un désert cruel.
Buonarroti : sur son visage, une ombre impénétrable –
que diable vient faire à cette heure à Florence
la bande de Raffaello et Da Vinci ?– se demande-t-il,
tout en s’imaginant la statue qu’il a fait surgir d’un bloc
de marbre, son David, soutenant son regard.
Un vent du sud souffle en tempête sur la chaussée,
dans mes pensées je m’ensevelis,
mon ombre, à petits pas, me suit sans bruit
et j’entends les poissons du fond de l’eau chanter.
Arrive Botticelli sur le trottoir, côté quai.
On l’a fait venir en ville, pour décider
de l’emplacement du géant de Michel-Ange.
L’idéal – songe le maître, du haut
de ses cinquante-neuf ans – serait la place
qui jouxte la mairie- et soudain lui apparaît
l’autoportrait d’Apelle de Cos.
Une jeune femme passe devant lui. Le visage est familier –
il se retourne, mais trop tard pour apercevoir ses traits.
Quand je peignais – songe-t-il – la naissance de Vénus,
je ne pensais pas à l’Aphrodite d’Apelle, même si le motif
du coquillage s’y rapportait comme le corps à l’âme.
Quel pouvait être le secret d’Apelle de Cos, comment
a-t-il pu peindre Alexandre le Grand et sa maîtresse Campaspe
en n’utilisant que quatre couleurs :
le jaune, le rouge, le blanc et le noir ?
Et la vertu, où était-elle, dans cet exploit ?
L’art doit être strictement réservé
au service de la religion – sur ce point
je suis d’accord avec Savonarole –
Un vent du sud souffle en tempête sur la chaussée,
dans mes pensées je m’ensevelis,
mon ombre, à petits pas, me suit sans bruit
et j’entends les poissons du fond de l’eau chanter.
Au-delà du fleuve, sur l’autre rive, pareil à Venus,
le pays bombe son torse de collines. Cèdres et oliviers
s’entretiennent sans éclats, sous un embrun subtil,
comme l’aile d’un papillon toute veinée de couleurs.
Puis quelqu’un parle, au loin, d’une voix aigrelette :
Gian Giacomo Caprioti da Oreno*,
voleur, tricheur, avide et obstiné,
il supplie Da Vinci, il l’implore
de ne plus jamais peindre
sous le nom d’Andrea Salai, qui l’humilie,
et si le maître a pour lui une once d’amour,
qui l’immortalise, lui !
Leonardo Di Ser Piero Da Vinci ne répond pas
et son regard balaie le vieil Arno : il se souvient
que peu de temps auparavant il a promis à Machiavel
qu’ensemble ils dessineraient des plans
pour détourner le cours du fleuve.
Mais Salai reprend la parole, chicane et veut
prouver son si fidèle amour.
Da Vinci capture la main qui gesticule
et le regarde au fond des yeux –
après ma mort – lui souffle-t-il – tu garderas Mona Lisa,
dont je suis moi-même incapable d’imaginer
le nombre des récits qui l’entoureront, et des légendes.
Elle inquiète même ce pauvre Raffaello :
car peu comprennent, cher Salai,
qu’un sourire,
oui,
un sourire auquel j’ai médité le plus clair de ma vie,
un jour égalera l’éclat du plus précieux diamant.
*De beaucoup le cadet de Leonardo, mieux connu sous le nom de Salai, il est resté pendant plusieurs décennies l’ami intime du vieux peintre.
A Kolojvar le souvenir
Pour le 85ième anniversaire d’Alexandre Kányádi
Je tends le bras et la vue porte
jusqu’aux limites de la mémoire,
je vois l’oubli de soi
dans la danse rouge et noire.
L’écarlate solitude revient
s’emparer de mon cœur,
où elle souffle et étreint
les plus noires des langueurs.
Quelque doute qu’on ait eu,
jamais on ne l’oublie ;
de nos joies tout au plus
restera le débris.
Bande de garçons, filles de leur âge,
roses écarlates et fleurs sauvages.
Muets, main dans la main, au crépuscule têtu,
leurs regards lumineux s’étreignent à l’imprévu,
sur leur bouche saigne et meurt un rayon du couchant,
la lune monte et cabre tous les chevaux du vent.
Filles du même âge, bande de garçons,
Au grand feu de la vie, flammes à foison.
Les garçons tout en noir, et tendus comme un nerf,
les filles ont sur les joues une rouge lumière.
Le Szamos coule entre ses rives muettes, hostiles.
Un souvenir, au-dessus de ses flots frisés, file.
Le reflet d’astres austères
y propage une senteur aigre.
Comme si cette danse était la toute première,
et comme si rien ne leur était plus cher,
bande de garçons, filles de leur âge,
roses écarlates et fleurs sauvages.
L’écarlate solitude revient
s’emparer de mon cœur,
où elle souffle et étreint
les plus noires des langueurs.
je vois l’oubli de soi
dans la danse rouge et noire.
Je tends le bras et la vue porte
jusqu’aux limites de la mémoire.