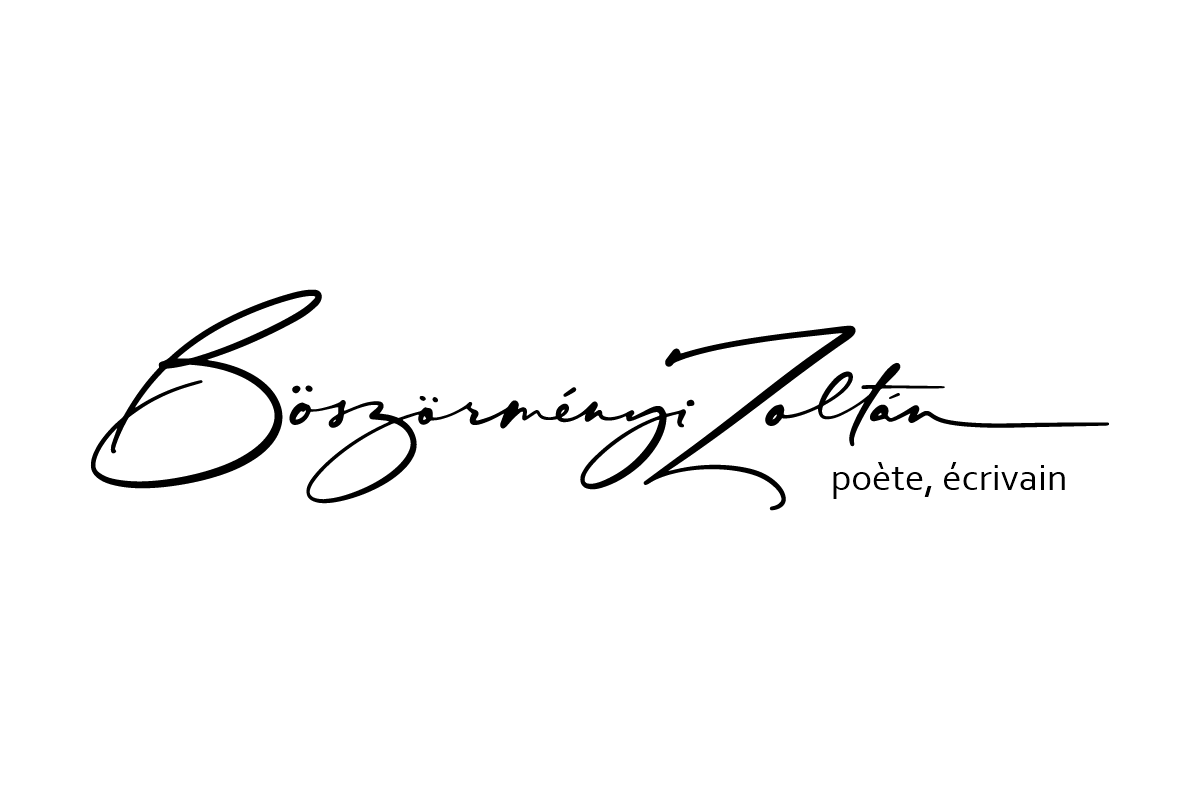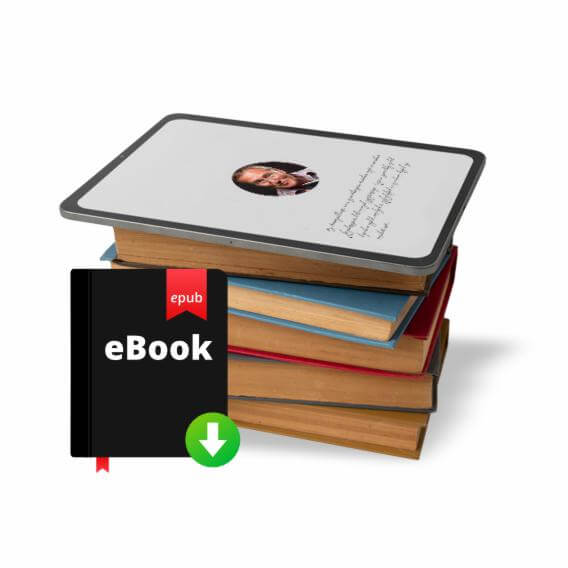Francesco Petrarca
Francesco Petrarca
Ma patrie, ce ne sont pas les collines d'Arqua
J'y reste un étranger comme en toute autre terre.
Mon pauvre père voulait que j'étudie le droit :
Je n'ai lu que Virgile, Cicéron, prose et vers.
Avant que d'enfouir mon cœur dans cette lumière,
Hanté par bien des anges et par plus d'un démon,
J'ai survécu à Florence et à Avignon,
Et du sonnet pourtant je ne suis pas le père.
Sachant l'histoire avant qu'elle ne s'accomplisse
Et les mètres latins qui sous ma langue se cousent,
Le regard de ma Laure m'accompagne complice
Jusqu'au pays sans vieux ni jeunes, et tout au bout
De mon destin tressé dans le destin d'Ulysse
Par ciel serein je brille au-dessus de Padoue.
Le parfum sublime de la vie
à John Updike, nuit du 27 janvier 2009*
Et te voici gisant sur la verte pelouse,
à l’ombre des montagnes couronnées d’or solaire.
Je te palpe.
Je pose sur toi mes paumes ardentes,
comme pour te demander : vis-tu encore ?
Me suis-je trompé ? M’as-tu trompé ? Vautour que tu es !
Toi le seigneur des seigneuries, le brigand en habits de lumière !
Tu as créé, mon Dieu, un monde bien éphémère !
Et moi qui te croyais, toi, Updike,
ambassadeur de l’éternité.
Tu ne trouveras, cher ami, où que tu sois,
pas de disciple plus fidèle que moi.
Car je dois te l’avouer : tous ceux
qui pendant ta vie t’ont revêtu de gloire
étaient de mensongers agents du siècle pourrissant.
Ils mentaient, t’étourdissaient de doutes,
te jetaient des os déjà rongés jusqu’à la moelle.
Regarde-moi !
Je profère ici, devant ton corps gisant, une autre prophétie :
Le pouvoir (l’argent, la possession) est un mirage.
Ne prête pas foi aux marchands du temple,
qui ne voulaient pas sauver leur âme,
qui ne veillait qu’à leur poche et ne tournaient leur yeux injectés
de sang que vers eux-mêmes.
Que ton fouet les réduise au silence,
montre-leur une fois de plus ce que peut le verbe,
l’élan, le feu, l’enthousiasme, le charme.
Mais est-ce à toi que j’explique la force de l’esprit,
à toi, l’indomptable, le guerrier viking ?
Cher ami,
prend-moi comme un chiot par le cou,
et filons dans le monde inanimé, dans le maquis des ombres.
Mais tu ne pourras ni ronger mon corps, ni y planter
l’arbre de la peur, car je me moquerai de toi.
Moi ! Tu parles !
Suis-moi plutôt à l’aéroport,
allons attendre les petits-enfants de retour de Dallas.
L’avion, sur le ciel enivré,
flotte dans le bleu de tes yeux, s’embrume, tend son ventre à la piste.
Imaginons que tout d’un coup, l’air de rien, il explose en vol,
qu’il disperse aux quatre vents l’impétuosité du cœur…
Cher ami, tu m’as roulé,
tu m’as laissé à ma Barbade solitaire,
que le Concorde même a délaissé.
Et pourtant comme j’aimerais prendre encore une fois le métro de New-York,
avec toi, pour un trajet ravi,
et avec cette merveilleuse fille au corps mince,
comme j’aimerais passer la main sous sa robe,
forer jusqu’à son slip
et, le doigt baignant sa chatte humide, m’écrier :
Quel goût sublime !
Le sens-tu, le parfum de la vie ?
*jour du décès de l’écrivain américain John Hoyer Updike.
Ballade de la douleur
Ses parents ont divorcé.
Il avait moins de huit ans.
De sa douleur, il parlait à tous :
aux voisins, à ses camarades d’école,
aux grands-parents restés au village,
et, sur le bord du lac, aux poissons nageant dans l’eau.
Il était si poignant, si touchant
en racontant encore et encore son histoire
et en tirait souvent l’impression
que personne d’autre en ce bas monde
ne saurait parler de la douleur de façon
si convaincante, si tragique et si sincère.
Le sort en avait décidé : il en fit son métier.
Il avait du travail tous les jours, on le payait bien,
juste pour parler, pour montrer l’invisible :
les flammes de la douleur lacérant l’âme.
Il s’était déjà retiré, et vivait solitaire,
quand une jeune fille l’a invité à se produire,
lui, le plus grand expert en douleur du monde.
Il resta des nuits entières à ruminer :
de quoi parlerait-il, comment et quand,
comment exemplifier, comment mettre en valeur cela
dont, tout sa vie, il avait parlé avec un tel succès.
Le public l’accueillit par un tonnerre d’applaudissements.
On lui lançait des fleurs, on l’acclamait debout.
Puis le silence se fit dans la salle,
On guettait ses paroles en retenant son souffle.
Mais lui, il se leva, et resta droit, tout raide, comme un sapin.
Mais plus un son, jamais, ne sortit de sa bouche.
En Caressant
Une tendre brise sert d’édredon aux fleurs de ce matin,
pétales de jasmin, de verveine, de pensées,
doigts de mains au repos sur la table de nos joies.
Ce matinal enchantement est une bourse des sensations,
il exige un savoir de céleste artisan
à qui veut en son sein mesurer le poids du secret,
de la patience, de l’extase et de l’attente.
Le long des raidillons de l’âme, le chardon du réel pique,
tel est le sentier que j’arpente avec toi.
En aval, un écho vagabonde : c’est le message des arbres.
La rêverie – soie dorée – flotte au vent devant nous,
obsessives symétries du désir, pigeonniers du fantasme.
nous agrippant aux voiles d’un même mirage,
qu’enfle le vent d’une volage harmonie,
nous enfonçons à deux dans la broussaille
le calice de l’amour physique.
L’univers se mélange à l’impatient désir,
avant que les choses, encore et encore,
ne nous rejettent dans la jungle du quotidien.
Apprend, mon amour, que la bonté en avalanche peut être insupportable,
autant que la malice, la tromperie, le mensonge,
l’alarmisme démesuré,
et pourtant rien n’est plus humble que la bonté.
Une goutte de pluie s’amuse au bout d’une branche de l’arbre qui nous fait face.
Je scrute tes yeux à travers un grillage de lumière,
comme si je vivais désormais en toi, et toi toute entière en moi.
Sous nos têtes, un amène oreiller de parfums.
Les ténèbres de l’infini nous bercent dans leurs bras,
alors que nous préférerions ceux du scintillement.
Une coulée de la lave de ton ventre me brûle
la langue tandis qu’en moi quelqu’un chuchote
que jamais plus je ne devrais te laisser me quitter.
Tendrement berce par le printemps perpeteuel de ta poitrine
Rêvons l’un de l’autre,
de l’été que l’amour chauffe à blanc,
de tout ce qu’une alerte imagination
nous a conduit à faire ensemble.
Rêvons l’un de l’autre,
déshabillons les monts, les vaux,
dénudons les prairies,
soulageons nos corps
du poids du souci,
comme un doigt léger touche la peau du temps.
Rêvons l’un de l’autre,
du moment où nous sommes la somme de nos désirs,
où les yeux enfiévrés lancent des flammes
où les lèvres se pressent sur les lèvres,
sachant que toute parole achoppera
devant le tendre bercement de ta poitrine,
et s’oubliera dans son printemps perpétuel.
Rêvons l’un de l’autre,
d’une union propre à faire pâlir
toutes épousailles, du faîte aride de la falaise
aride, où gisent à bout de souffle, main dans la main,
la joie du corps et, tout juste sorti du rêve,
le renouveau.