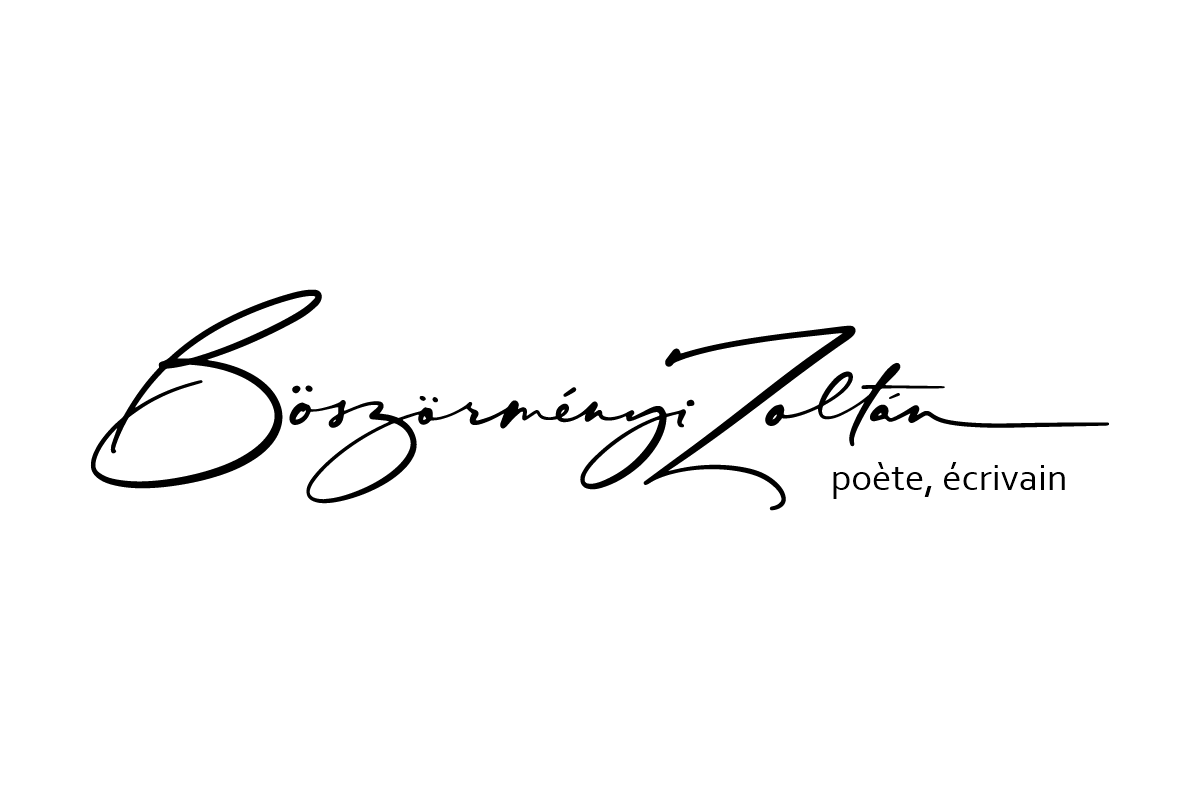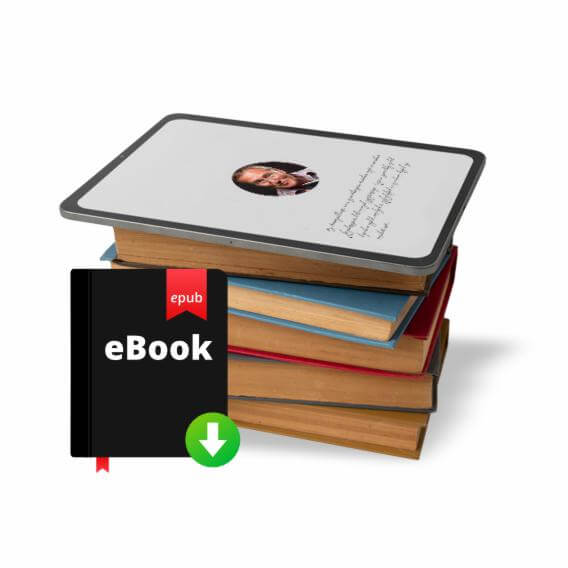Le temps long
Quand je ferme les yeux, je vois Maman. Toujours elle. Personne d’autre qu’elle. Tata dit qu’elle est maigre et moche. Moi je trouve pas. Elle a les cheveux courts, un peu bouclés. Et sa bouche est si jolie quand elle sourit ! Elle a les yeux rieurs. Etincelants, bleu ciel. C’est ce que j’aime le plus. Ils me plaisent encore plus que les rayons du soleil.
Mamie, aussi, n’arrête pas de dire du mal d’elle. Souvent, elle m’engueule, comme si c’était ma faute, si « ta truie de mère t’a encore larguée, elle me refile le bébé pour aller faire la pute, et maintenant qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, malheureuse ?! Ça va être à moi de te donner à manger, de t’emmener à l’école, de te laver, de t’habiller ? »
J’ai pleuré, parce que ce que Mamie disait de Maman, ça peut pas être vrai. Mamie comprend rien aux choses. Pourtant, Maman le lui dit toujours, quand elles se crêpent le chignon, que pour s’en sortir faut de l’argent. Maman, pour se défendre, me l’a souvent répété : « On gagne pas d’argent sans travailler. C’est pour ça que je dois partir. Elle le sait bien, que dans ce trou, y a pas de travail. Elle s’imagine peut-être que ça me fait plaisir, de partir en lui laissant ma fille sur le dos ? ». En entendant ça, Mamie lui criait : « Mais toi, tu pars pas pour travailler, mais pour faire la pute ! ». « Et alors, c’est peut-être pas du travail ? Travailler, c’est travailler. » A ce moment-là, je me remettais à pleurer, parce que j’arrivais pas du tout à m’imaginer comment on travaille en faisant la pute. C’est certainement pas ce que Maman voulait dire. C’est Mamie qui réussit toujours à la faire sortir de ses gonds, avec sa voix de sifflet. Quand on en arrive là, toutes les deux en sont déjà aux hurlements. Moi, je me précipite vers Maman pour la défendre, parce qu’il est déjà arrivé que Mamie lui foute sur la gueule, et c’est moi qui ai dû les séparer. Mais Maman m’a repoussée. Alors j’ai couru dans le coin me cacher sous la petite table. J’avais le cœur si serré de peur que j’ai plus eu la force d’en ressortir. J’attendais là, dans l’espoir que tout ça allait bientôt s’arrêter, que Maman, comme d’habitude, allait se précipiter hors de la pièce et claquer la porte derrière elle. Mais ça ne s’est pas passé comme ça : elles ont continué à se dire des gros mots. J’ai dû me boucher les oreilles. J’ai fermé les yeux, en pensant à l’arbre qui est au bout du jardin. Quand je suis triste, c’est toujours là-bas que je me réfugie. Je lève les yeux pour voir son feuillage, je le prends dans mes bras comme je prenais Maman, et je lui dis comme je suis malheureuse, et que j’ai beaucoup de peine. L’arbre secoue ses branches, comme pour parler. Il les secoue toujours, même quand il n’y a pas de vent. Et moi, je comprends ses paroles de consolation. On reste ensemble jusqu’à ce que ma tristesse passe.
Quand on m’a amenée dans cette chambre, Maman était avec moi. J’étais couchée sur une civière. Je me sentais si faible que mes yeux se fermaient de fatigue. On m’avait transférée depuis un autre hôpital. Pendant qu’on me transportait vers l’ambulance, j’ai entendu les médecins se disputer. Y en avait un qui voulait me garder, il insistait, disait qu’il allait me guérir, « me remettre sur pieds » – qu’il disait –, tandis que l’autre me donnait plus de chances si on me transfère ailleurs. Ça fait longtemps que j’arrive plus à marcher. Ça aussi, ça a fait tout un scandale, parce que Mamie est allée à l’école, pour annoncer qu’il a dû m’arriver quelque-chose pendant les grandes vacances, qu’elle ne comprend pas pourquoi, mais que depuis le mois d’août j’arrive plus à me lever. Une fois, j’ai essayé, mais j’ai failli m’affaler. Si le matelas n’avait pas été là, j’aurais pu me faire mal. Mamie aussi, au début, elle pensait que j’en fais qu’à ma tête, et elle me houspillait, que je me lève, que j’arrête mes bêtises. Je lui ai dit, moi, que c’est pas des conneries, que j’arrive pas à me lever. Elle est venue, elle a tiré les draps et a essayé de m’aider à me lever, mais elle avait beau s’efforcer, y avait pas moyen. « Ce que je peux être malade, mon Dieu – qu’elle disait, en se frappant le sein gauche –, pourquoi m’avoir ajouté ce boulet ? Comme si je n’avais pas assez d’ennuis ! En plus, faut que je m’occupe de cet avorton, de cette bonne à rien ! » – elle gémissait en se tenant les reins, portant sans arrêt la main à son cœur, tout en criaillant. « Qu’est-ce que t’a fait ta pute de mère, malheureuse ? Où est-ce qu’elle t’a emmenée cet été ? Qu’est-ce qui a bien pu lui passer par le bourrichon pour qu’elle te retire à ta Mamie et qu’elle t’emmène chez cette garce ? Allez, lève-toi, parce que mon cœur va lâcher, et là tu feras la gueule, parce qu’une fois que j’aurai passé l’arme à gauche, je me demande bien qui va s’intéresser à toi ! » C’est à ce moment-là qu’elle a déguerpi, pour aller à mon école.
Les grandes vacances venaient de commencer, quand Maman m’a annoncé qu’elle allait m’emmener chez son amie Lola, dans un village pas loin. Je devais y rester jusqu’au début de l’école. Elle, il faut qu’elle reparte en Italie, gagner de l’argent. Mais elle fera en sorte que je vive mieux là-bas que chez Mamie. Comme ça, j’aurai pas à écouter toute la journée les jérémiades de la vieille, à se plaindre qu’elle doit me nourrir sur sa petite retraite. Que je lui mange même son pain à elle. Alors que moi, j’ai jamais été une grande mangeuse, je lui demandais à manger qu’une fois par jour, le soir, quand j’avais très faim. Je voulais pas que Mamie perde tout ce qu’elle a en me nourrissant, je voulais rien lui prendre. Elle, elle a jamais été travailleuse comme Maman. Même le jardin, elle était pas fichue de l’ensemencer au printemps, Maman avait beau lui dire : « la petite aurait bien besoin d’un peu de verdure, de salade, d’épinards, de trucs comme ça », mais elle, elle en avait rien à faire, elle préférait rester assise toute la journée sur la véranda, à regarder devant soi. Moi, j’allais la voir, parce que je me sentais seule, et je lui demandais : tu fais quoi ? – mais elle, elle me chassait : que je m’en aille, que j’arrête de la déranger, que je la laisse se reposer. Et est-ce que je voyais, maintenant, quelle sorte de mère j’ai ? Elle ne revient même plus au pays, comme si je n’existais pas, madame voyage et mène la grande vie, madame s’amuse, passe d’un type à l’autre, mais pour s’occuper de moi, prendre soin de moi, ah ça non, c’est trop pour elle, ah, pour ça, je pouvais lui faire confiance : elle a gâché la vie de sa mère, pas seulement la mienne. Elle m’a chié là, et puis elle m’a laissé en plan. Voilà ce qu’elle disait. Et puis aussi que j’aurais mieux fait de pas naître du tout, parce que ça serait mieux pour moi, au moins je souffrirais pas, et sa vie à elle aussi serait plus facile, une bouche de moins à nourrir, et elle parlait, et parlait, ça n’en finissait plus, elle pouvait pas s’arrêter, de maudire Maman, moi, le monde, de me déverser toute son aigreur sur la gueule, comme si j’étais venue au monde spécialement pour qu’elle me pourrisse avec chaque mot sorti de sa bouche, et quand je croyais qu’elle en avait enfin fini, que c’était terminé, que je pouvais aller jouer, elle me rappelait comme j’étais minable, chétive, une prématurée minuscule, qui aurait tenu dans un mouchoir de poche, un vrai miracle, que je sois restée en vie – seulement voilà : à quoi bon ?
C’est ce qui me revient à l’esprit quand je parle avec l’arbre au bout du jardin. Et je lui dis tout ce que je dirais pour rien au monde à personne.
Je reste sous l’arbre et je chante pour lui.
Une fois, en classe, Irina a dit que les plantes aiment les chansons. Les chansons les font grandir et les rendent plus fortes.
Moi, ça fait longtemps que je chante plus pour personne.
Quand j’étais petite, je demandais parfois à Maman de chanter pour moi, mais ça, c’était y a très longtemps. Je me souviens même plus de ces chansons. Pourtant, Maman a une si belle voix. Qu’est-ce que j’aimerais l’entendre de nouveau. Ça me dérangerait pas qu’elle chante pour moi toute la journée. Parce qu’alors, elle serait avec moi, rien qu’avec moi.
*
J’ai pas beaucoup de vêtements, mais ceux qui étaient dans le tiroir, je les ai rassemblés, et on les emballe avec Maman. Je voudrais emmener aussi mes sandales, mais y en a une qui a une sangle cassée. On l’examine, on la retourne dans tous les sens, peut-être bien qu’on pourrait la réparer, mais en fin de compte, c’est juste une perte de temps, on réussit même pas à la recoller. Du coup, on les jette à la poubelle. Pourtant, j’aimais bien ces sandales, avec leurs petites striures marron. Je me rappelle comme j’étais heureuse quand je suis allée avec Maman au magasin m’acheter des chaussures d’été. C’étaient pas vraiment les sandales qui me rendaient heureuse, mais de passer du temps avec Maman, parce que je pouvais me blottir contre elle et lui tenir la main, bien serré, si serré que ma main venait se coincer entre ses doigts pour ne plus s’en détacher. Après avoir payé à la caisse, Maman m’a tendu la boîte en souriant et m’a dit, si gentiment : c’est pour toi, ma petite chérie ! Ça m’a fait très plaisir. J’ai pris la boîte blanche dans mes bras, je l’ai serrée contre ma poitrine, j’ai repris la main de Maman, et je suis repartie en sautillant de joie à côté d’elle.
Dans mon petit sac, je peux faire rentrer toutes mes affaires, je mets mon lapin en peluche gris par-dessus mes vêtements, pour qu’il ait un lit moelleux pour se reposer pendant le voyage. Depuis la porte, je jette encore un coup d’œil au sac poubelle, en espérant voir une dernière fois les sandales, leur dire adieu – à mon retour, de toute façon, elles seront plus là –, mais je les vois nulle part. Derrière la station de bus, il y a un grand parc. Un après-midi, je suis venue ici avec toute la classe. La maîtresse nous a dit que ce sont les Allemands qui l’ont aménagé, il y a quelques siècles. Les Allemands aiment les grands parcs, grandioses, c’est ce que nous a dit la maîtresse. Entre les platanes, ils ont construit tout un tas de chemins pavés. Un jour, il y a longtemps, il y a eu une grande épidémie, beaucoup de gens sont tombés malades et sont morts. En leur mémoire, un monument a été érigé au milieu du parc, un immense obélisque. Mais c’était y a si longtemps que le grand oiseau en pierre au sommet du monument était devenu à peine visible, et on savait plus quelle sorte d’oiseau c’était. J’ai essayé beaucoup de fois de deviner quelle espèce ça pouvait bien être, mais tout ce qui me venait à l’esprit, c’était l’aigle. L’aigle est un oiseau très fort, qui peut tout vaincre. Peut-être qu’il peut même vaincre la mort.
Moi j’aime ce parc, j’aime bien jouer ici. Et à chaque fois que je pouvais, c’est ici que je venais avec mes camarades de classe. Mais j’ai jamais pu emmener Mamie avec moi, elle disait qu’elle avait mal aux pieds et elle essayait toujours de me convaincre de pas y aller : à quoi bon, hein, là-bas, y a des mauvais esprits, tu peux tomber malade, qu’elle grommelait ; t’as pas vu l’obélisque ? – même lui arrive pas à éloigner les âmes en peine ! Ce serait mieux de rester jouer ici, au fond du jardin. De construire une cage pour le lapin en peluche gris. Une fois, je l’ai suppliée longtemps, et des larmes me sont montées aux yeux, tellement j’étais triste de pas pouvoir aller au parc. Mais elle, elle a encore piqué une crise, elle s’est mise à engueuler Maman – moi, ça m’a fait éclater en sanglots, je trépignais et je lui disais que ce serait mieux de me tuer tout de suite, si je suis tellement vilaine que je peux même pas aller jouer au parc, que j’en pouvais plus, que je savais plus ce que je faisais encore dans ce monde. Ce jour-là, elle a même plus parlé avec moi, et le soir, elle m’a même pas donné à manger ; ça m’a pas trop punie, de toute façon, j’avais perdu l’appétit. J’ai rien dit à Maman, même si, plusieurs fois, j’ai eu envie de tout raconter.
A la station d’autobus, je tiens la main à Maman, je regarde les arbres du parc, et je me dis : comme ils sont bien, comme ça, parce que eux, ils doivent aller nulle part. Alors que moi, je dois de nouveau quitter Maman, être loin de celle que j’aime tellement, et je peux même pas lui dire comme ça me fait mal de la quitter, même si elle part que pour quelques mois. Si je pleurs, elle me répète toujours que c’est pour moi qu’elle part, que c’est pour moi qu’elle travaille, pour me rendre la vie meilleure, c’est ce qu’elle dit, mais moi de toute façon j’arrive pas à comprendre tout ça, ça sert à rien qu’elle essaye de me persuader que c’est pour moi qu’elle part, pour moi, que c’est rien que pour moi qu’elle fait tout ça. Pourquoi elle comprend pas que c’est pas bien pour moi de pas être avec elle, comme ça me fait mal qu’elle soit pas avec moi ? Mais je me retiens, je dis rien, parce qu’elle finirait par s’énerver elle aussi, par me crier dessus comme Mamie.
On est au bord du parc depuis quelques temps, mais l’autobus veut toujours pas pointer le bout de son nez. Pendant ce temps-là, y a beaucoup de monde qui passe, certains disent bonjour, mais y en a aussi qui font mine de regarder ailleurs, ce que moi je considère comme quelque chose de très impoli. On m’a appris qu’il faut dire bonjour à tout le monde, que c’est bien de faire comme ça. Ensuite, il y a le père George, notre voisin, qui vient s’arrêter près de nous, il nous demande où on va, mais Maman n’est pas de très bonne humeur, elle lui dit juste qu’on va dans un village aux alentours. Moi je l’aime beaucoup, le père George, quand il me voit jouer dans la rue, il me dit toujours de venir chez lui, dans sa cuisine, et il me donne des fruits. Mais je les accepte pas souvent, parce qu’une fois Mamie m’a surprise au moment où j’entrais chez lui et m’a grondée très fort, que c’est pas assez que je sois une minable vaurienne, en plus je trouve moyen d’aller mendier chez les voisins – qu’elle disait. Alors, quand, de temps en temps, j’accepte une pomme du père George, je la mange sur place ou je la cache, pour pas que Mamie voie ce que j’ai reçu.
*
J’ouvre les yeux et je regarde autour de moi. Le lit à côté de moi est vide. Dans la chambre, y’a personne. C’est tellement bien quand je suis seule. Je peux garder les yeux ouverts, personne va commencer à râler parce que je réponds pas aux questions. Eux ils croient que je le fais exprès et que je suis têtue comme une mule ; ils comprennent pas que je peux pas parler, que j’ai perdu ma voix, que j’ai plus de mots. Même à Maman je lui ai plus parlé, je lui ai seulement écrit. Et pourtant, j’ai été tellement heureuse le jour où elle est revenue me voir sans prévenir. J’ai cru qu’elle m’avait encore quittée, qu’elle était fâchée contre moi, parce que j’étais malade et qu’elle m’en voulait à moi pour toutes les mauvaises choses qui lui étaient arrivées. Elle est aussi fâchée contre moi à cause de Mamie, même si j’y suis pour rien, pour absolument rien.
Je me sens mieux ici que dans l’autre hôpital. Les murs sont propres, blancs. Très blancs. Hier matin, les rayons du soleil se sont glissés dans la chambre. Ils flottaient, dansaient, se balançaient. Plus tard, j’ai remarqué l’arbre qui est en face de la fenêtre. Quand le vent agitait ses feuilles, l’ombre et la lumière dansaient sur le plancher et sur le mur qui fait face à la fenêtre. Une fois, pendant le cours de dessin, la maîtresse s’est fâchée contre moi, parce que j’ai pas fait ce qu’elle avait demandé. Elle voulait qu’on dessine au-dessus des collines un soleil brillant, un soleil qui illuminerait le paysage. Au lieu de ça, j’ai dessiné des nuages, beaucoup de nuages gris et noirs. Quand elle l’a remarqué, elle m’a fait me lever, a pris la feuille devant moi, l’a soulevée d’un air furieux et l’a montrée à toute la classe : « regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, quoi, qu’est-ce qu’elle fabrique, votre petite camarade ! Il lui manquerait pas une case, à celle-là ? » Certains se sont mis à rire, puis, tout d’un coup, ils se sont tus. Un silence de mort s’est installé dans la classe. Je restais debout à côté du banc, en me dandinant, et des larmes coulaient sur mes joues, tellement j’avais honte de pas avoir dessiné ce que nous a demandé la maîtresse. J’étais triste, parce que Maman était de nouveau partie en Italie, et je m’entendais pas bien avec Mamie. Elle était toujours énervée après moi, elle hurlait à tue-tête, se plaignait que Maman avait pas envoyé d’argent depuis deux semaines, alors qu’elle avait promis de le faire ; maintenant, Mamie avait plus un sous, elle avait plus de quoi nous acheter à manger. J’ai pas compris pourquoi elle faisait un tel scandale, j’avais rien fait de mal, et même si j’avais faim, je lui avais même pas demandé à manger, juste pour qu’elle s’énerve pas. Je suis partie à l’école sans prendre de petit-déjeuner, j’ai même pas pris de goûter avec moi. J’ai dit à Mamie que j’ai pas besoin de manger, que je peux aussi faire sans. Quand Maman viendra, à ce moment-là je mangerai, parce qu’elle, elle prend soin de moi, elle m’aime, elle passe pas son temps à me crier dessus. J’ai pris mon cartable et j’ai voulu ouvrir la porte du portail, celle qui est peinte en vert, mais elle s’était encore bloquée, et j’avais beau tirer, j’ai pas eu la force de l’ouvrir ; j’ai attendu un moment, en espérant que Mamie vienne m’aider. Elle a mis assez longtemps à remarquer que j’étais toujours devant la porte. Elle est venue en râlant, et m’a dit qu’elle allait préparer une soupe de pommes de terre pour mon retour.
Ça fait un bout de temps que je regarde la lumière qui danse sur le plancher. L’ombre et la lumière jouent à cache-cache, comme nous à l’école pendant la récré. C’est comme ça que Michou a couru après moi dans le couloir. Il a toujours été gentil avec moi, une fois il a pris ma défense, quand Louise et Anita se sont moquées de moi, parce que je suis tellement maigre. Je leur ai dit de me laisser tranquille, que tout le monde peut pas être comme elles, qui ressemblent à des choux farcis. Pendant une récré, il m’a pris par la main, il m’a emmenée faire une promenade dans la cour, et quand personne regardait, il m’a chuchoté à l’oreille que j’ai de beaux yeux, puis il m’a reconduite dans la classe. A la récré suivante, j’ai couru aux toilettes et je me suis regardée dans la glace. J’ai vu des yeux noirs, je sais pas pourquoi Michou m’a dit qu’ils sont beaux. Moi j’aimais pas mes yeux. Mais pour un temps, ça m’a rendue heureuse, enfin, je crois que le bonheur c’est ça, parce que des picotements agréables m’ont parcouru tout le corps.
Mais parfois, comme maintenant, tout devient brumeux autour de moi. C’est là que je dois fermer les yeux pour retrouver tout ce que j’ai dans ma tête. Pourtant, j’aurais bien aimé continuer à suivre les jeux de l’ombre et de la lumière. Ça détourne mon attention de ce qui m’arrive. Je pourrais retourner chez Maman, lui dire comme elle me manque. Quand ils m’ont amenée ici, j’ai vu sur son visage qu’elle se faisait du souci pour moi. Elle a demandé aux médecins pourquoi ils m’ont amenée ici, pourquoi ils peuvent pas me soigner là-bas. L’un d’entre eux lui a répondu, un peu brutalement : « parce que votre fille ne veut pas guérir, Madame ! Vous devez comprendre que votre fille est très malade, un enfant de onze ans ne peut pas faire dix-huit kilos. Son organisme a subi des altérations pathologiques. On ne sait pas comment s’y prendre. Elle ne veut pas se nourrir, elle ne parle pas avec nous, elle n’écoute pas ce qu’on lui dit. Psychologiquement, votre fille est gravement malade. » « C’est pas possible – a protesté Maman –, elle a pourtant tout ce qui lui faut, je lui procure tout le nécessaire, je suis même partie en Italie l’été dernier, pour gagner plus d’argent et lui acheter ceci-cela, de nouvelles sandales, parce que les autres avaient une sangle cassée. » « Madame – a répondu le médecin –, votre enfant n’a pas besoin de nouvelles sandales, mais de vous ; mais bon sang, comprenez que vous seule pouvez l’aider ! Restez avec elle, parlez-lui, aimez-la, prenez-la dans vos bras, caressez-la, dorlotez-la, vous seule pouvez la convaincre de se remettre à manger. »
« Alors c’est ça le problème... c’est ça le problème... » – répétait Maman et, vu comme elle se tordait les mains, je me suis rendu compte qu’elle s’était encore énervée. Mais je pouvais pas l’aider, et je voulais pas qu’elle soit nerveuse à cause de moi, qu’elle fasse une crise, comme quand elle se fâche avec Mamie. Moi je voulais qu’une seule chose, qu’elle soit avec moi, avec moi pour toujours, et plus jamais la perdre.
Zoltán Böszörményi: Le temps long (traduction de Raoul Weiss), Editions du Cygne, Paris, 2023