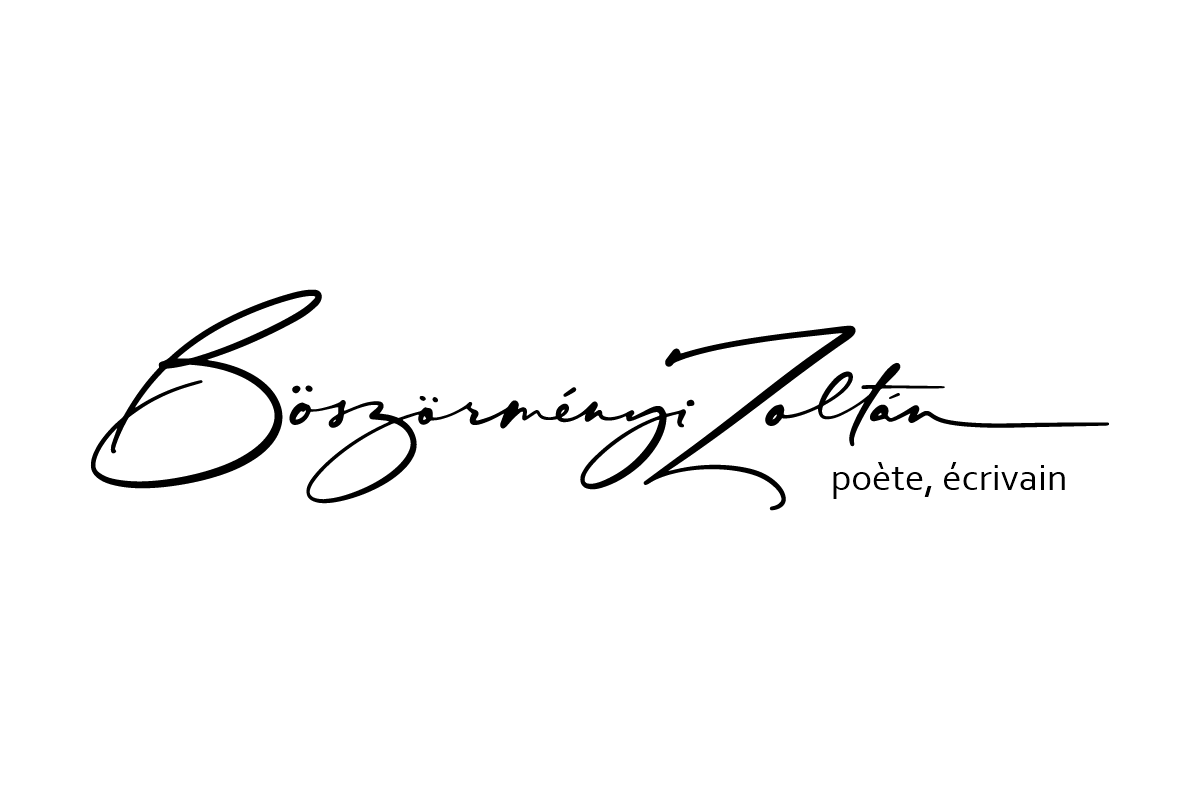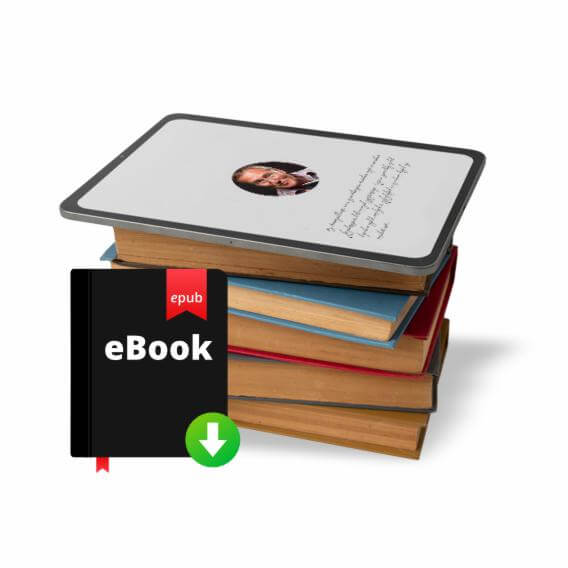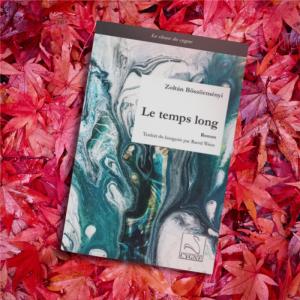Rencontre avec le patron des lettres hongroises
Les pourfendeurs de la Hongrie de Viktor Orbán n’en finissent plus de dérouler leurs arguments fallacieux dirigés contre une nation d’Europe centrale dont ils ignorent souvent tout, à commencer par sa littérature. Éléments est allé à la rencontre de Zoltán Böszörményi, figure centrale de la littérature hongroise contemporaine, né en 1951 en Transylvanie, tour à tour dissident, refugié politique, capitaine d’industrie, directeur de revue littéraire et Président du PEN Club de Hongrie, à la fois philosophe, romancier et poète.
Propos recueillis par Yann Caspar, journaliste franco-hongrois basé à Budapest.
De nombreux écrivains — souvent les plus mauvais — rêveraient de faire fortune grâce à leur plume. Vous êtes la preuve de l’existence d’une logique totalement inverse. Après un succès dans le monde affaires, vous avez décidé de revenir à votre véritable passion, la littéraire. D’aucuns y verront là un choix étrange. Pourquoi et dans quelles conditions avec vous pris cette décision ?
Intéressant. Écrire, ce serait donc rêver de gagner beaucoup d’argent ? Pour ma part, je n'ai jamais écrit pour l'argent, et j'ai l'impression que même les auteurs de polar ne créent pas uniquement pour l'argent. Dans l'art de l'écriture, il y a quelque chose de magique, de transcendant, d’insaisissable. Merleau-Ponty en parle dans son essai philosophique paru à titre posthume Le visible et l'invisible. Celui qui écrit endosse un rôle, pas seulement littéraire, mais aussi social, économique et politique. Il exprime sa façon de penser le monde, y compris la place de l'homme, tout ce sur quoi ses prédécesseurs ont déjà planché. Celui qui écrit soulève constamment des questions existentielles et cherche des réponses. Celui qui écrit se cherche à chaque instant, en méditant sur lui-même et sur son rôle universel, si tant est que cela existe. Car l'écriture est à la fois action, profession de foi, engagement, prise de responsabilité, audace, tension, agitation, rébellion, révolution, passion, amour, folie, plaisir sceptique, libération, monomanie. Je suis retourné à la littérature, parce que je pensais avoir quelque chose de nouveau à dire. Je sais qu'Aristote a souligné dans La Poétique que les écrivains ont déjà abordé tous les sujets plusieurs fois et qu'il n'est pas nécessaire de produire de nouveaux écrits - mais je sui d’un avis différent sur ce point. C'est pour cela que j'ai recommencé à créer.
Vous semblez en permanence tiraillé entre la poésie et le roman. En France, l’on a pour habitude de penser que le roman est un genre certes noble mais daté, dans lequel tout a été dit, alors que la poésie est un domaine inépuisable et sans limites, le véritable terrain de jeu des grands écrivains. Qu’en pensez-vous ?
Je me suis mis à écrire des poèmes dès mon plus jeune âge. Je croyais pouvoir changer le monde. J'ai grandi avec les poèmes de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, de Paul Éluard, d’Apollinaire, ou encore de Mistral. Adolescent, je déclamais les poèmes de Jacques Prévert à mes camarades. J'ai rencontré Yves Bonnefoy à Budapest, lorsqu'il a reçu le Grand Prix de la poésie Janus Pannonius des mains de mon ami poète Géza Szőcs, qui avait fondé ce prix des années auparavant, le qualifiant de « Nobel de la poésie » hongroise. Le roman n'est pas un genre obsolète, je dirais plutôt qu'il est en constante évolution et transformation. Michel Houellebecq est mon auteur préféré, j'ai lu tous ses livres, et bien qu'il soit un excellent romancier, il se doit parfois de choisir la poésie pour exprimer certaines choses. Une écrivaine canadienne célèbre, Margaret Atwood, pense de la même manière, j'ai lu ses excellents recueils de poèmes. Je considère les deux, Houellebecq et Atwood, comme de grands romanciers, mais c’est peut-être dans la poésie que se trouve leur véritable terrain de jeu.
Dès le début des années 2000, vous vous êtes montré visionnaire en pressentant que des évolutions profondes étaient en cours dans notre rapport au travail, à la sexualité et à l’argent. Quiconque lira votre Tant que je penserai être paru aux éditions du Cygne en conclura que vous avez un côté très houellebecquien…
C’est pas faux. Cependant, lorsque j'ai écrit Tant que je penserai être, je n'avais encore rien lu de Houellebecq. Il peut y avoir des points communs entre ses romans et le mien, car nous travaillons tous deux avec la même matière humaine. Personnellement, j'associerais plutôt mon roman à René Descartes. Il s’agit d’un roman court, passionnant, plein de rebondissements et de suspense, et j'y ai ajouté un peu de philosophie et de poésie. Il a été publié au Canada sous le titre Far from Nothing, et de nombreux exemplaires se sont écoulés.
Tout cela concerne avant tout l’Occident, que beaucoup disent malade. C’est cela qui vous pousse à écrire ?
De nos jours, nous avons tendance à qualifier l'Occident de société malade. Mais je crois que, au cours de l'histoire, toutes les sociétés ont eu leurs maladies. Ce n'est pas seulement le cas des XXe et XXIe siècle. Il ne dépend que de nous de la guérir. Les écrivains peuvent beaucoup y contribuer, car avec chacune de leurs œuvres, ils appellent à l’auto-examen, provoquent la société en place. Ils nous tendent un miroir, et ce que nous y voyons nous effraie parfois. La bonne littérature a un pouvoir d'organisation, de mobilisation et de guérison sociale. Parmi les exemples, citons entre autres les œuvres de Prévost, Voltaire, Rousseau, Molière, Balzac, Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola, Stendhal, Baudelaire, Martin du Gard, Gide, Camus, Aragon, Sartre, Gary, de Beauvoir, Duras, Houellebecq, Arneaux, dont les romans, nouvelles, essais, poèmes ont ce pouvoir. L'âme de la société se nourrit de ces œuvres.
J’ai toujours eu du mal à vous définir. Vous êtes à l’aise aussi bien dans les tripots des Carpates qu’à la table des princes à Monaco ou aux côtés d’oligarques slaves dans les Caraïbes. Comment vous définiriez-vous ?
Je suis parti pour le Canada en 1984 depuis le camp de réfugiés de Traiskirchen, en Autriche. Mon roman REGAL évoque mon exil de Transylvanie et les événements vécus dans le camp. Mon ami Raoul Weiss l'a traduit, et j'espère qu'il sera publié cette année aux éditions du Cygne. En 1998, je suis arrivé à Monaco, et j’y vis depuis. J'ai rencontré plusieurs fois le Prince Albert II, et une fois il m'a accueilli dans son bureau lorsque je lui ai remis mon recueil de poèmes La peau de rien, dont seulement trois exemplaires ont été imprimés sur un papier spécial fait main. Je passe trois à quatre mois de l'année à la Barbade. C'est là que j'ai écrit tous mes romans et mes recueils de poésie. Sur les rives de la mer des Caraïbes, surtout en hiver, je peux m'immerger complètement dans l’écriture et lire à l'ombre des palmiers. J'ai vendu mes usines et mes affaires en Roumanie il y a vingt-et-un ans, et depuis je ne m’occupe plus que de littérature et d’édition. Depuis vingt-quatre ans, je suis le rédacteur en chef du magazine mensuel Irodalmi Jelen (« Présent hongrois »), et j'ai fait construit une maison de la culture dans ma ville natale, Arad, en Transylvanie.
Vous connaissez bien la France, un pays qui encore aujourd’hui jouit d’un peu de prestige culturel à l’étranger, peut-être de manière exagéré. Quel regard portez-vous sur ce pays ?
Depuis mon enfance, j'adore la France, sa culture, sa langue et ses traditions. J'aime sa littérature, ses arts, ses musées, ses églises. En surtout : j'aime le peuple français. Je le regarde avec admiration et respect. À Monaco, dans mon appartement, je garde fièrement un coq gaulois en porcelaine sur lequel il est inscrit « Chante clair pour la France ». Chaque fois que je suis à Paris, je visite la tombe de Voltaire et de Rousseau au Panthéon. Quand il m’arrive de passer devant l'Hôtel des Invalides, j’y entre pour m'incliner devant le tombeau de Napoléon. J'ai à peu près parcouru tout le pays, de l'Atlantique à la Méditerranée. La France a toujours été l'une des nations déterminantes de l'Europe, et elle l'est toujours aujourd'hui.
La Hongrie fait aujourd’hui l’objet de toutes les passions. Beaucoup se prononcent sur ce pays sans connaitre sa littérature et encore moins sa langue. C’est bien pour cela que cela parution de vos ouvrages en langue française est salvatrice. Comment expliquez ce manque de connaissance sur un pays pourtant si proche de la France ?
La Hongrie a complètement changé après la Première Guerre mondiale. Peu de gens se souviennent que, à la suite du Traité de Trianon, le pays a perdu les deux tiers de son territoire et plus d'un tiers de sa population. Il n'y a pas d'autre pays en Europe qui ait été ainsi mutilé. Seule la Transylvanie, qui lui a été arrachée, faisait 103 000 kilomètres carrés. La Hongrie actuelle est plus petite de quelques milliers de kilomètres carrés, soit 93 000. Mon pays a beaucoup souffert depuis 1920. Cela est oublié au sein de l'Union européenne. Comme si les faits historiques n'existaient pas. Après cela, tout le monde s'étonne que Viktor Orbán se bat pour le reste de sa nation. Nous sommes un petit peuple, à peine dix millions d’habitants, mais notre langue, notre culture, notre foi chrétienne et nos coutumes font partie intégrante de l'Europe, et je l'affirme sans crainte, de l'ensemble du monde. Nos écrivains, poètes tels que Mór Jókai, Sándor Petőfi, János Arany, Endre Ady, Attila József, Árpád Tóth, Lőrinc Szabó, Dezső Kosztolányi, Kálmán Mikszáth, Zsigmond Móricz, László Németh, Margit Kaffka, Béla Hamvas, Sándor Wöeres, László Nagy, János Pilinszky, Géza Szőcs, et bien d'autres, ont enrichi la littérature mondiale avec des œuvres sans lesquelles elle serait aujourd'hui plus pauvre. La Hongrie est un peuple digne d'amour, petit mais d'une grande richesse spirituelle.