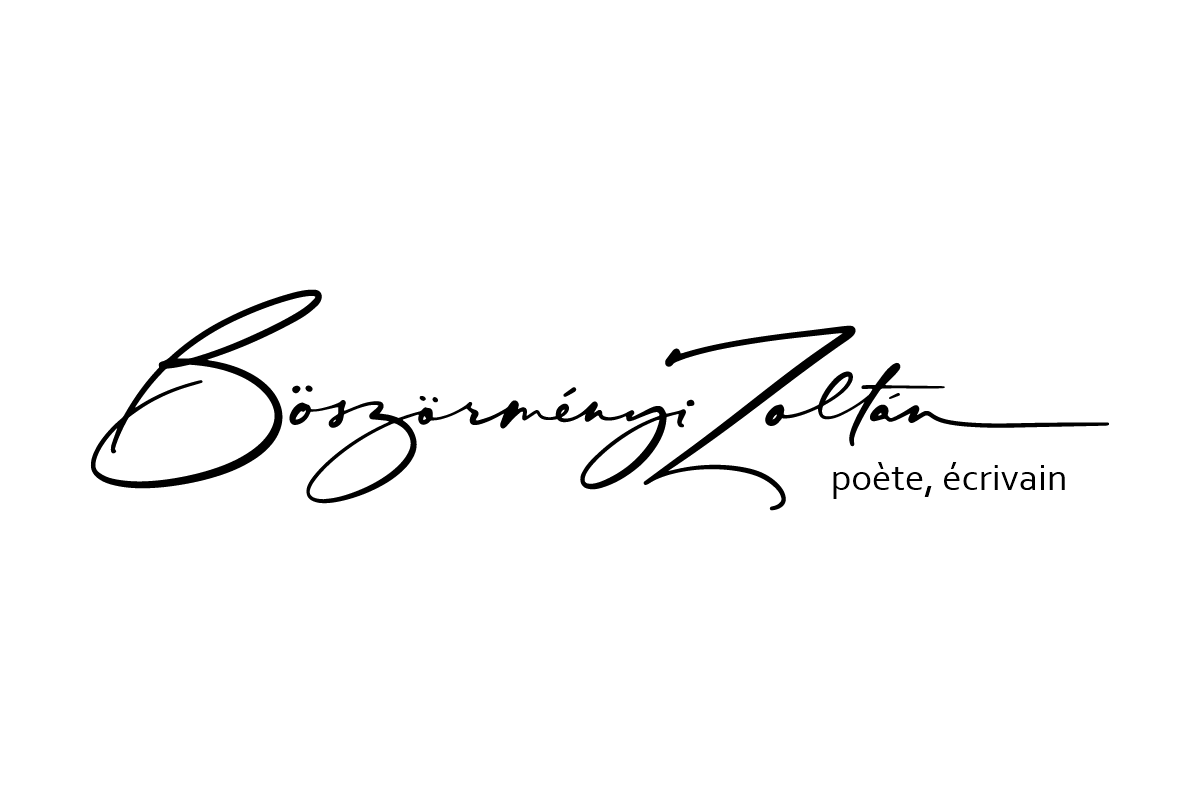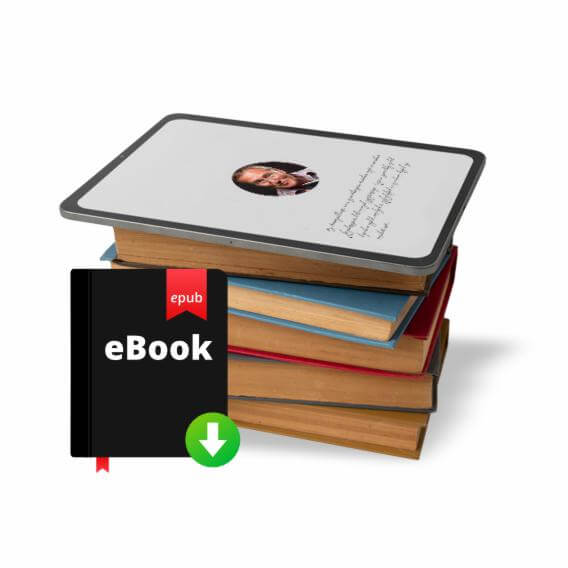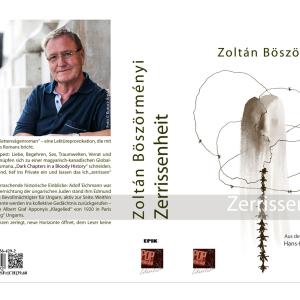Matin a San Francisco
Matin a San Francisco
Retourne-toi vers ce jour-là,
Fonds l’Acropole de la lumière en un secret,
fais tinter le châssis du temps,
une meute de rêves a pris son vol, échappe à ton toucher,
l’adolescent brouillard tremble devant tes muscles.
Le matin, traînée rougeâtre,
galope, s’évanouit devant tes pas,
il a peur
de se faire marcher dessus,
ton humeur et ta compréhension du monde
ayant – cela reste entre nous – la gueule de bois.
La pourpre du Golden Gate dissout
ses cellules d’acier dans l’océan,
et de son mât fiché dans le gris d’un nuage
lacère les entrailles de l’ennui.
Le paysage se déshabille.
Où que tu regardes,
entre les immeubles endimanchés
des automobiles,
ces poissons métalliques projetés sur la rive,
un printemps rôde, étincelant.
Sur le trottoir, quelques pas devant toi,
le vent de service passe son balai.
De retour à l’hôtel,
au frais sous les arcades,
monologue en sourdine sur les lèvres des hôtes,
devant l’ascenseur un gosse trépigne.
Sésame ouvre-toi,
Néon jette un éclair,
l’atmosphère est ici si différente :
chemise de ouate.
La paix du corridor tressaute,
sur les murs, en noir et blanc,
des photos d’époque,
les larcins de la nature :
immeubles effondrés sur leur douleur
en mille neuf-cent six,
un regard, et la terre à nouveau tremble.
En entrant dans la chambre,
tu recherches la clé du futur,
hier encore, elle y était :
tout au fond de la poche de la veste pendue au dossier du fauteuil,
sous-marin immergé au fond de la mystique,
plongé dans la vision,
submarine vagabond.
Poeme de luxe cinq etoiles
A Lawrence Ferlinghetti, qui en 2012 a d’abord accepté, puis refusé le grand prix de poésie Janus Pannonius décerné par le PEN Club hongrois.
Ceci est un poème de luxe. Cinq étoiles.
Mais il est interdit d’y fumer.
On a viré par la porte de service
Bob Dylan et Ginsberg.
Mais rien n’empêche de chanter :
Minnesota
Mines de soda
Sarasota
Ça rase au tas
Dans le hall, des flots de miel.
Assise dans ses fauteuils, la conscience est muette.
Sa décision est prise : elle arrête de se scinder.
Pour aujourd’hui.
On fait défiler des chèvres du Caucase,
(même ça, on en a le droit)
à l’ombre du vent solaire.
Même Tandori[1] en a marre, de ce temps xylophobe,
et disserte malgré tout gaiement de l’être et de l’évanescence.
A quoi bon tenir la totalité en laisse,
faisons, inversement,
des plus noirs des seins
le plus blanc dessin.
au ciel de l’œil
un écureuil
Par ici, on aime les monomaniaques
à la Hamvas,
on les encastre, on les mure dans le champ de bataille,
on les imagine bien mûrs.
Et que faire des incubes ? – demandent les ébahis,
– il faut recoder leurs gènes,
à quoi bon cette brouettée de charabia,
ces vieilleries, ces maharadjas – paix sur la terre !
qu’ils emménagent dans du bâti, et se sapent à crédit !
c’est la mer ! sel amer !
(Par ici, à la fabrique d’idoles !)
Faites péter les torgnoles !
Uovo strapazzato : c’est la fierté du chef.
Son parfum remplit, comme de mouches à merde,
tous les salons de Manzonis et de Flauberts.
Mais que faire des incubes ? – demandent les ébahis,
Mangia !
Et les autres, ils faisaient quoi ?
Sur leur cul, dans la bibliothèque, ils lisaient Steinbeck :
“I can tell you folks are not from Oklahoma.
I mean no offense, but you sound a little funny.”*
Ou peut-être Móricz :
« Les petits diables, tout la bande,
ont tendu une planche,
et l’ont fait se tenir
à son extrémité.
-------------------------------------------
Ça va pas, encore un mot barré.
– C’est un poème, que vous écrivez ? »**
Et s’amusaient de constater
que, même dans le fumoir, fumer est interdit
(même avoir froid, c’est pas permis).
Ceux qu’ennuie la paix du rez-de-chaussée,
qu’ils se ruent à l’étage,
pour regarder CNN live,
un manteau sur le dossier,
une bouteille, un cru de 2010,
par la fenêtre grande ouverte, des gouttes de pluie
s’engouffrent dans la chambre, télégraphient
en morse sur son parquet,
si brutalement
qu’elle réveilleront la solitude
(éventuellement).
Ce n’est pas l’angle qui permet de voir
la maison natale de Dante,
mais à quoi bon ? On la rénove depuis dix ans
(un filet couvre l’échafaudage),
le passé a la couleur du chocolat.
Souvenir tardif. Soirs, que parcourt le souffle de trains frais
d’un vol fragile vers le passé, le bel oubli.
Nous te devons notre idéal et notre sang. La tête haute,
son doute muet, et sur les ruines du doute, une joie neigeuse.
Voilà comment nous rêvons le matin, debout sur ses crêtes, un mince
rayon tout étourdi, de la lumière trébuche dans le giron des causes.
Le soir n’est qu’un souvenir, fraîchement survolé par le train des nuées.
Hôtel Patagonia
et sa cour, pleine de magnolias.
En contrebas des Torres del Paine, tu te reposes.
Leur silence éternel devient élan.
Tu fixes l’excursion par la photo.
Sur les buissons du rêve, des épines nous poignardent.
(On ne peut pas fumer, là-bas non plus.)
Si on ne peut pas,
si on ne peut rien,
ni comme ça, ni autrement,
rien créer,
tu protestes en vain,
il en sera ainsi, que nenni autrement,
la politique n’est pas ta suzeraine,
parole fauchée sur les barricades de l’esprit,
et Jean Csezmiczei ne chantait pas pour rien :
« C’est la terre de Pannonie qui, à l’âge le plus tendre,
m’a fait venir ici, depuis la contrée où,
avant d’oublier ses vagues et son nom
dans le Danube, d’un cours déjà calmé,
la Drave sépare de gras labours. »***
En terre hongroise,
l’arbre de l’humanisme est déjà grand,
le chant magyar, non plus, n’est pas d’hier,
et nous voilà,
certes vaincus,
mais Dieu rend illustre notre nom.
* John Steinbeck (1902-1968), Grapes of Wrath
** Zsigmond Móricz, Légy jó mindhalálig
*** Janus Pannonius, Guarino-panegyricus
[1] Dezső Tandori (1938-2019), l’un des poètes hongrois les plus innovants de sa génération.
Cathedrale de l’Hiver eternel
A seize ans je ne voulais pas
sauver le monde, mais j’imaginais
une sorte de révolution,
de quoi se défouler
(C’est bien là la moindre des fantaisies
d’un garnement au menton duveteux.)
La révolution, d’ailleurs, il n’y avait rien
de plus évident pour quiconque était né
dans la ville des treize martyrs, c’était pas
midi à quatorze heures :
descendre des poulies d’acier du lieu,
du milieu, de l’histoire, équivalait
à se mesurer aux grands anciens, à suivre
leur exemple jusque dans la mort héroïque : Damjanich,
Pöltenberg, Knézich en auraient dit de même.
Tout au plus feraient-ils remarquer :
« Faudrait trouver moyen de faire ça
plus intelligemment, fiston. »
Pouvais-je prendre en compte cet avertissement ?
Pouvait-il avoir alors la moindre signification ?
Je n’en sais plus rien. Ce que je sais,
c’est que les révolutions à base de mal du siècle
– collectives ou en single –
sont inutiles et méprisables.
Reste donc le verbe, bon à épingler sur de saints drapeaux,
le verbe dans lequel cent et mille fois déjà
s’est consumé tout l’univers.
Nul défi plus noble que de se consacrer
à une lutte éternelle, tout en devant
se préparer son bois de chauffe tous les matins,
et de songer, tout en fendant ses buches,
à ce que nous prépare l’avenir.
Le béton des murs de l’avenir laisse
moins de place aux récidivistes de l’évasion.
Pour échapper à tous vos ennuis,
enfoncez votre tête dans le sable,
ne vous occupez pas de ce qui se passe là-dehors,
ni de ce qui se passe là-dedans.
Le destin, quoi qu’on fasse, nous réserve un hiver long,
que votre obstination s’y creuse un tunnel,
si vous voulez rendre indéniable votre déni,
et rentable votre investissement.
Sur un tel fond, la main déjà presque blanche a bonne mine,
et personne ne se plaint des conclusions tardives,
d’avoir perdu instant après instant,
des hauts et des bas de la cinquième saison,
de voir chaque nuit bien trop
facilement s’y dissoudre.
Tous vous aideront à avoir froid.
Mais ce qu’il y a d’inoubliable, ce sont les grands idéaux
et leurs chaises musicales : synode par-ci, cinoche par-là.
Le reste est réaction épidermique.
L’univers devient invisible, la respiration
s’accélère, on perd, aussi, plus facilement,
une fois emboué, qui peut bien se souvenir
comment ça s’est passé – et quoi ?
Un habit neuf jaillit de l’armoire,
miraculeux changement, les racines, à quoi bon,
elles s’étiolent en dernière analyse.
L’esprit se cherche des prétextes,
vérifions le cours de la sincérité :
telle un joyau d’antiquaire,
elle décorera mon living-room.
Que de cadeaux dans cette débauche,
et combien de malentendus !
Le long des lignes brisées, l’attention s’égare,
la pensée glisse et se déconcentre,
et demain restera égal à demain,
que d’aucuns se retrouvent – ou pas – bloqués dehors.
Le sort des petits poissons manque de tragique,
dans la grande procession, il tourne vite au détail.
Engendrée par la nuit la plus dense,
la peur grandit sous le manteau des brumes,
elle est déjà si grande que j’en oublierai vite
de qui j’ai conservé le verbe.
J’ai fait la course avec tous ces automnes.
Sur la planche de départ, d’abord, il n’y avait qu’eux,
puis mon tour est venu.
Le stock d’amok s’est épuisé.
Les jours étaient pâles, anémiques,
les nuits tuberculeuses,
j’y ajoutais un jeûne de mots,
et parfois, dans leur gêne, les arbres bordant
la route me tenaient des discours d’ivrognes.
Je prenais les avions pour des grues,
et j’attendais de m’envoler avec l’une d’elles.
A Világos
ça devient moche
équation muette
on a pris perpète
de chaque fait
je reste prisonnier
On a fait reluire
le dessus de la table,
mais qui s’en souvient,
les eaux du temps ont emporté
la chaise, le chapeau,
et depuis lors, sans cesse
nous chiffonnons la honte,
et mitonnons
un genre de nostalgie,
qui nous mitonne,
et l’histoire tremble avec nous,
dans son uniforme métallique
plein de marques au poinçon.
Görgei le Grand
nous a mis là-dedans
La patrie est perdue,
le bruit des batailles s’est tu,
reste l’honneur et rien de plus,
et depuis lors, il neige, énormément.
Ame hongroise immergée dans l’éternel hiver,
je te vois encore bien et t’espère,
les couteaux bien coupants
restent vifs dans mon cœur,
je construis pour l’hiver éternel une cathédrale.
Comme on cache dans l’hiver ses trésors,
oublieux de sa voix, de sa mine, de son visage,
c’est en vain qu’on tire les cheveux de l’âge,
en vain qu’on ravale ses cris d’alerte,
on encaisse en pure perte :
attendre des jours meilleurs ? – très peu pour moi.
Je vous lègue donc la cathédrale de l’hiver éternel.
Majorana de passage a Kolojvar
Aujourd’hui, je n’ai pas pu creuser plus profond,
je ne sais quel souvenir baille au café du coin ,
la tour de la Citadelle et ses environs
me font signe, un inconnu
m’appelle à sa table et m’offre un cognac,
mais rien de tout cela ne laissera de vécu, ci-gît,
devant moi, sur la table, l’aile lasse d’une mouette.
Dans la pirogue du mot, je franchis des frontières de dimensions,
il me tend des bouquet de vécu,
du vécu que j’aurais pu vivre,
si le destin s’était soucié de moi,
au lieu de me laisser traîner, en grolles trouées,
par les rues de Kolojvar, main dans la main avec le vent.
A l’enfant que j’étais alors, il manquait
le zèle, le calvaire de l’espoir,
le mirage tâché de magie des horizons lointains.
La solitude et la rage tournoyaient devant mes yeux,
clouant en duo des planches sur les fenêtres borgnes.
Le manque, encore, on le supporte,
on le porte avec fierté, chemise blanche du dimanche,
on s’en vante, on fait son sage à la Virgile,
mais la faim, impossible de la chasser de nos pensées,
on veut en faire abstraction, mais elle revient
avec les météorites du réel dans notre ciel,
et frappe de plus en plus fort celui
qui a le privilège d’expier.
Le voilà surpeuplé, le Golgotha de la pensée.
Le vide sidéral se dilate,
sur le néant gelé
les rives du Szamos projettent une ombre étrange.
Ici Shakespeare aurait pu se promener en paix,
loin de Londres et des soucis du quotidien,
et pourtant au plus près de ce que quotidiennement
nous devons feindre, dire, sentir, prétendre.
Le théâtre alors était vraiment théâtre,
et les saules de la rive, ramollis de lumière,
le temps rougeoie sur les branches de l’âme,
tandis que la mystique gonfle dans le corps
des légendes qui restent à raconter, des pierres
qui restent à traîner, du sentiment
de déchéance, de la force hautaine
des océans que depuis lors j’ai parcouru.
Moi, la sauterelle,
depuis lors chaque soir,
assis sur la rive sablonneuse,
je chante parmi les clignements d’étoiles ensommeillées.
Recette magique
Hommage à Béla Hamvas
– Je suis monomaniaque, Monsieur,
à l’image de mon impossible génération, de celle
qui n’a pas perdu tout sens de cet art du style
qu’on appelle romantisme. (Je suis incapable
de m’en défaire.) Découvrir le sens du désastre
est l’activité définitoire de mon existence,
mon état naturel, ma seule façon de m’épanouir.
Mais je n’en continue pas moins à vous écouter, Monsieur,
et j’accepte vos bons conseils, ruminant tout ce que
vous m’avez appris, ce dont des générations entières,
vous plagiant ou citant, ont fait parade devant moi,
épinglant au drapeau de leurs triomphes
votre victoire comme si c’était la leur.
La carence de l’esprit demande quelque intelligence,
tout nier d’un geste élégant : plus qu’une pose,
c’est, per excellentiam, un mode de vie,
dans lequel la part active de l’imagination s’isole
de sa part indolente, pour finalement laisser
tranquillement toute l’affaire à cette dernière.
– C’est vrai, Monsieur, que rien de tout cela ne musclera le monde,
qui n’en deviendra que plus gris, plus chic, plus chaotique.
(C’est ce que certains nomment le délire sacral.)
Le bourbier, le dédale, l’absence de fins, appelez ça
comme vous voulez – mais de nos jours, c’est à la mode.
Ça ne perd pas une minute à créer du neuf. Ça végète –
telle est la nouvelle méthode de production d’esprit :
s’immerger dans le rien comme énergie formatrice d’histoire.
(Car enfin, végéter, postillonner de minuscules critiques
au visage d’autrui, c’est un plaisir assuré.)
– Je vous l’ai déjà dit, Monsieur,
je suis monomaniaque, un calviniste au cerveau plâtré –
pardon : un nihiliste, dans l’illusion latente
des formes déformées, des caractères perdus,
qui pense que l’humeur des masses est plus facile
à jauger que leurs besoins et pentes spirituelles.
– Vous voyez : j’ai laissé tomber mon masque. A visage découvert,
voici de quoi j’ai l’air. Serais-je fait pour vous plaire ?
J’ai dépassé depuis longtemps la question critique de la réalité.
Mon seul pouvoir, c’est l’âme. (Les forçats de la faim repasseront !)
J’ai des besoins modestes, de monomaniaque, incapable
de dire de soi-même quoi que ce soit d’inessentiel.
Le talent me manque aussi – dans le fouillis, parfois,
j’arrive à faire de l’ordre, quand je ne suis pas saoul,
sachant que je vis dans un monde ivre de pouvoir (confusion),
et qu’un avenir apocalyptique m’attend (je regrette même déjà
de l’avoir écrit, car si le concept pique du nez, certains
pourraient en prendre ombrage) ; mu par un délirant désir de vie,
je prévois mes affaires privées – telle est ma lubie,
l’agitation qu’on m’a léguée ; l’humour habite plus haut
que la tragédie, alors même que devant et derrière le rideau
des théâtres, l’un et l’autre sont de même force (quand ils sont sages) :
ils commencent tous deux par rire d’eux-mêmes,
et moi aussi, je ris de moi, Monsieur, étant risible,
ma vie est une tragédie mineure – faible (velléitaire)
je suis, je fus et je serai, qu’à mes côtés (l’espace-)
temps s’agenouille ou non, moi le monomaniaque, je suçote
la sucette-réalité, l’amère ! Le paradis s’est réfugié
sous l’abri de l’imagination. Lui sait des choses dont moi
je n’ai pas la moindre idée. Pour l’instant. De toute façon, le capital
(ou sa peine) m’avalera. S’échappant du maelstrom
de l’ouï-dire, j’entends le cri des moralistes ;
de ces bribes de paroles je déduis que celui
que l’espoir conduit est un danger public (un criminel ?).
Ce monde anormal, ils cherchent
à le rendre dingue. Pour ce faire, ils ont des idées,
du temps, du fric, de l’énergie – et le trou d’une serrure.
Le trou de serrure, pour quoi faire ?
Pour épier les fantaisistes, les filous,
les inquisiteurs, et bien sûr… moi.
(En apprenant tout ça, j’ai le visage aussi gris que le plomb.)
„l’Amor che move…” Aimons Dieu ! Jusqu’à la pâmoison !
Mais que fera le Tout-puissant de tout cet amour ?
N’est-il pas las de notre hypocrisie ? Ou dégoûté de cette adoration
surfaite ? Ne soupçonne-t-il aucune arrière-pensée
derrière nos mots sublimes, aucune requête, supplique ou intérêt
usurpant la si pure, la simple et gratuite révélation ?
Aurait-on fait, Monsieur, un business de la religion ?
Des aigris, des déments, des débiles vous tisseront
des guirlandes, d’allégresse. (Aimez donc les sophistes !)
Tout doucement j’élèverai la passion qui m’habite :
mon petit saint deviendra grand – tel est mon rêve.
(Succubes, démons, fantômes : mythologie
pour une personne. Rien de ce qui nous arrive n’est vrai.
Seules les générations suivantes comprennent nos rêves.
Nous les rêvons en réalité pour elles.)
La vie n’exige qu’une chose : qu’une passion soit vécue,
voilà toute la recette magique. (Les fous sont une sous-espèce
de l’homme normal : ceux qui ont vu mentir un homme
sain d’esprit. Le monde n’a pas besoin d’être changé,
mais d’un mensonge qui le nie. Vous le savez mieux que quiconque !)
C’est l’impulsion, la crampe de l’attachement qui donne au tout
sa cohésion – et la monomanie.