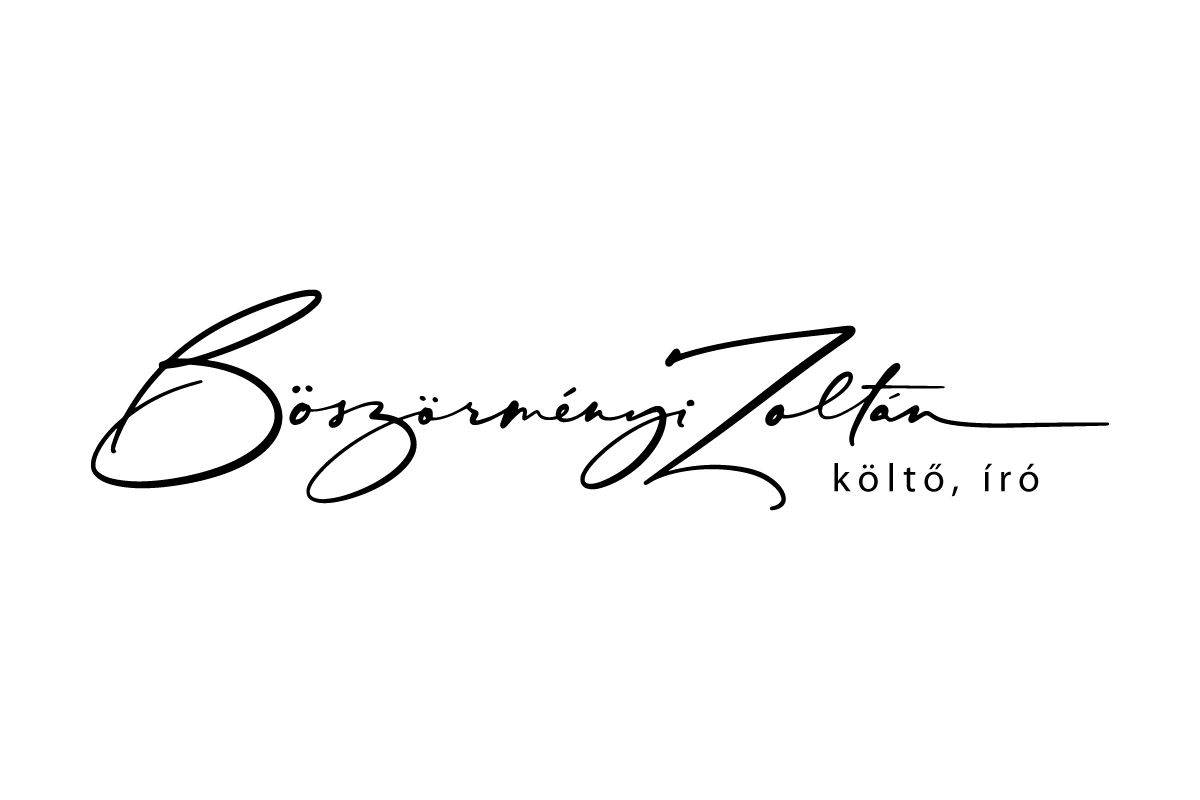Zoltán Böszörményi, poète et auteur hongrois : une rencontre
Né en 1951 au sein de la minorité hongroise de Roumanie, tour à tour dissident, réfugié politique, capitaine d’industrie et directeur de revue littéraire, Zoltán Böszörményi est à la fois philosophe, romancier et poète (prix József Attila de poésie en Hongrie en 2012). Ses œuvres ont été traduites dans une demi-douzaine de langues. Il est entre autres Directeur du journal culturel Irodalmi Jelen et Président du PEN Club de Hongrie. A l’occasion de sa venue en France, pour la présentation de son dernier roman, Le Temps long, traduit par Raoul Weiss, paru aux Editions du Cygne, il a répondu à quelques questions à propos de son écriture, romanesque, et poétique, et de ce que signifie cet acte, écrire. Un entretien dirigé par Kaïna Bendar à partir de questions proposées par Julie Bietry.

Pourquoi avoir choisi une « petite fille » en tant que narratrice ?
J’ai vraiment connu cette fille. Certes, quand elle ne parlait déjà plus. Sa mort m’a choqué. Je n’ai pas pu m’y faire, pendant plusieurs jours. J’ai beaucoup réfléchi à son sort. Pourquoi s’est-elle laissée mourir de faim ? Pourquoi personne ne lui a expliqué quand il était encore temps qu’il y avait un moyen de sortir de ce calvaire ? L’amour maternel est important. Mais un professionnel, un psychologue, aurait dû lui expliquer que sa mère l’aimait malgré tout, certes différemment, mais qu’elle l’aimait. Que nous ne sommes pas tous pareils et que nous exprimons notre amour de différentes manières. Avant de commencer à écrire ce roman, j’ai enfilé les habits d’un journaliste d’investigation en me rendant au domicile de la jeune fille, j’ai parlé à sa grand-mère — la mère n’était pas à la maison à ce moment-là -, à ses proches, je me suis rendu à l’école où elle étudiait, j’ai contacté son ancienne professeure.
Mais cette dernière ne pouvait pas et ne voulait pas parler honnêtement de cette histoire, elle m’a envoyé auprès de la directrice. J’ai également contacté le maire de la petite ville, qui a répondu à mes questions ouvertement et honnêtement, et m’a donné le nom et le numéro de téléphone de l’assistante sociale en charge des enfants. J’ai appris que l’école n’avait pas de psychologue pour enfants, que l’assistante sociale n’avait pas reçu la formation nécessaire pour aider la fillette et que cette dernière avait été transportée à l’hôpital alors que son état était tellement détérioré qu’elle pouvait à peine marcher. J’ai rassemblé beaucoup d’informations et il ne me restait plus qu’à commencer à écrire le roman. Mais je n’y arrivais pas. J’ai travaillé sur le texte pendant des semaines, mais je n’arrivais à rien. Je suis resté assis devant l’écran de mon ordinateur, abasourdi, et aucune pensée ne me venait. Plus d’un mois s’est écoulé, jusqu’à ce qu’un matin, je me rende compte que j’avais moi-même grandi sans mère. Pendant des années, j’avais cherché l’amour de ma mère, sa présence, ses caresses, la chaleur de son âme m’avaient manqué. À l’âge de soixante-sept ans, je suis entré dans le rôle de cette fillette et j’ai écrit ce livre en à peine un mois.
Que vous évoque l’anorexie ?
Il existe deux types d’anorexia nervosa. Tous deux sont dus à une perte d’appétit. Le premier type est appelé boulimie. Elle se manifeste surtout chez les adolescents qui se se font vomir ou refusent de manger par peur de devenir obèses. L’autre type, également un trouble nerveux, est le résultat d’une sorte de rébellion. En l’occurrence, la jeune fille refuse de manger pour attirer l’attention de sa mère, dont elle a besoin de l’amour. Il existe une phase de la maladie, décrite pour la première fois par le Français Ernest-Charles Lasègue et le Britannique William Gull en 1873, où la dégradation totale du corps est inarrêtable et aboutit à la mort. Il n’existe pas de traitement pour cette maladie, c’est pourquoi elle est si fatale. Moi aussi, j’aspirais à l’amour de ma mère, mais je me rebellais autrement, je tombais dans la mélancolie, je vivais dans une mélancolie douloureuse et j’étais envahi par une léthargie constante.
Comment définiriez-vous le personnage de la mère dans votre roman ?
Le comportement de la mère et son mode de vie sont un fil rouge qui traverse le roman. Elle n’a pas fait beaucoup d’études, elle est peu cultivée. Bien qu’elle aime sa fille de manière abstraite, elle est incapable de comprendre ce dont son enfant a besoin. Elle n’a aucun sens de l’attachement parce qu’elle n’a jamais été attaché à personne. Sa vie affective est morne. Elle change beaucoup de partenaires. Elle part travailler à l’étranger parce qu’elle veut gagner sa vie plus facilement, si possible pour trouver dans son travail de la détente et du plaisir physique. Quelque part, elle est consciente de sa responsabilité envers son enfant, mais ses instincts maternels sont mêlés d’insouciance et d’ignorance. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille aspire à son amour, parce qu’elle-même n’a jamais vraiment aimé personne. J’ai éprouvé des difficultés à présenter le comportement contradictoire de la mère, à dépeindre son personnage. Quant à sa présence, sa relation avec sa fille, j’ai essayé de rester objectif et laconique. Moi-même, je ne pouvais pas m’identifier à elle, elle était si repoussante, si cruelle.
Avez-vous songé à une fin différente ?
J’ai plusieurs fois pensé à sauver la vie de la jeune fille, une fin heureuse m’est venue à l’esprit. Mais à chaque fois, je devais me rappeler que cette forme d’anorexie mentale est fatale. Au-delà d’une certaine limite, on ne peut pas y survivre. Bien sûr, je voulais que la jeune fille se rétablisse, qu’elle quitte l’hôpital et que, plus tard, lorsqu’elle aurait éventuellement un enfant, elle l’aime comme personne d’autre. Son amour pour son enfant aurait été la catharsis de sa vie. Mais dans ce cas, cela aurait été un autre roman, un autre type de fiction.
Est-ce que l’écriture de ce livre vous a soulagé d’un poids dans votre vie personnelle ?
Non. Ma propre expérience de vie, l’absence de ma mère, n’a fait qu’intensifier la douleur due à cette détresse émotionnelle. Je ne voulais pas revivre les événements de mon enfance, mais plutôt souligner la tragédie et le manque d’expression de cet état émotionnel, qui n’est comparable à rien d’autre. Quand j’ai écrit sur le destin de cette jeune fille, j’y ai aussi inclus mon propre destin, avec toutes les angoisses qui déchirent la chair et les douleurs au plus profond de l’âme. Le Momo dans le roman La vie devant soi de Romain Gary (Emil Ajar) verse de l’eau de Cologne sur le cadavre en décomposition de Mama Rosa en insistant avec dévotion sur le fait qu’elle ne peut pas accepter sa perte. Il ne peut accepter sa mort parce qu’il l’aime farouchement, de manière indiscible, à la folie. Si vous aimez quelqu’un, si vous l’aimez de tout votre être, de toute votre âme, vous ne pouvez pas vous en séparer.
Dans ce roman, vous avez choisi de mettre à l’écart la figure paternelle. Pourquoi ?
Ce n’était pas une question de choix. Mon père a toujours été présent dans ma vie, mais pas comme un symbole d’amour, d’affection, de loyauté. Beaucoup d’hommes sont incapables de se sacrifier pour leurs enfants. Je pourrais citer d’innombrables exemples parmi mes proches et mes connaissances. Les hommes se comportent différemment. Pour eux, la paternité n’est pas une épreuve, une expérience écrasante dotée d’une force indomptable. Ils ne portent pas l’enfant dans leur ventre pendant neuf mois, ils n’accouchent pas, ils n’ont pas leur corps lié par un cordon ombilical, ils n’ont pas leur bébé suspendu à leur poitrine pour allaiter. La maternité est un don de Dieu, et Dieu ne l’a donné qu’aux femmes. C’est pourquoi elles sont privilégiées, différentes de nous, les hommes.
Avez-vous dû vous-même « fermer les yeux » sur certaines choses quand vous étiez enfant ?
J’ai été le témoin oculaire et auditif des disputes de mes parents à plusieurs reprises. Ils étaient très méchants l’un envers l’autre. Je me disais que s’ils répétaient sans cesse qu’ils s’aimaient, pourquoi se comportaient-ils de manière aussi hypocrite ? Pourquoi se lançaient-ils des mots au vitriol ? Pourquoi criaient-ils ? L’âme de l’enfant est une chose très sensible, elle peut être facilement endommagée. Non, je n’ai pas fermé les yeux quand mes parents se disputaient, jouaient au chat et à la souris, je me suis simplement caché. Parfois sous la table, parfois derrière la bibliothèque. Chacune de leurs disputes me causait une douleur physique. La petite fille du roman ferme les yeux parce qu’elle veut se cacher de la réalité – elle ne peut plus bouger, c’est vrai — mais cela lui permet aussi de se souvenir plus facilement des moments de sa courte et douloureuse vie.
Pensez-vous que ce roman est perçu différemment selon le pays dans lequel il est publié ?
Beaucoup d’exemplaires ont été vendus en Hongrie et les critiques ont afflué. En Roumanie, j’ai été interviewé à la télévision parce que l’histoire de la petite fille avait suscité beaucoup d’émotion chez les gens. L’édition roumaine a également été particulièrement importante car tout le monde savait que l’enfant était originaire de Transylvanie, et de nombreuses personnes avaient entendu parler de cette tragédie dans les journaux et à la télévision. Aujourd’hui, il y a plus de 150 000 enfants en Roumanie dont l’un ou les deux parents vivent et travaillent à l’étranger, et je pense que ce chiffre est sous-estimé. Ces enfants sont élevés par des grand-parents, outre membre de famile, ou des voisins. Avec mon roman, j’ai aussi voulu attirer l’attention des autorités et du public sur ce phénomène tragique. Ces enfants seront psychologiquement endommagés et cela les affectera pour le reste de leur vie. Lorsque j’ai présenté l’édition russe du roman à Moscou, de nombreuses femmes ont fait la queue pour une dédicace, et la lecture de passages y a eu beaucoup de succès. Mais c’est probablement en Allemagne que mon livre a eu le plus de succès jusqu’à présent. La directrice des bibliothèques allemandes, après avoir lu mon roman, a demandé aux bibliothèques de se le procurer. De nombreux exemplaires ont été vendus. Par ailleurs, le livre est aussi paru aux États-Unis et en Espagne. Je suis très heureux que mon livre soit publié en français, et je remercie tout particulièrement Raoul Weiss pour la traduction et M. Patrice Kanozsai, fondateur et directeur des éditions Cygne à Paris, pour la publication.
Quelle est la différence entre la prose fictive et narrative et le langage poétique ?
J’utilise beaucoup l’imagerie poétique dans ma prose. C’est inévitable, au fur à mesure que le texte et les évènements avancent, ils se transforment inévitablement en poésie. Ces images poétiques se retrouvent dans tous mes romans, Le temps long et surtout Tant que je penserai étre. Ce dernier, je l’espère, sera publié au printemps prochain aux Éditions du Cygne. Je pense que la prose d’aujourd’hui a besoin d’images poétiques, parce que c’est ce que l’écrivain veut utiliser pour impressionner le lecteur, pour évoquer un espace et un milieu qui le fascinent, créent une tension et des vagues émotionnelles.
La poésie peut-elle être un guide, un stimulant pour l’humanité, révélant que la paix est possible et peut être créée entre nous ?
Le monde d’aujourd’hui est différent de celui des XVIIIe et XIXe siècles. À l’époque, la poésie avait le pouvoir de créer le monde et l’âme. Au XXe siècle, bien que la production des poètes soit exceptionnelle, son pouvoir semble avoir diminué. L’impact de Baudelaire, de Verlaine et d’Apollinaire sur la société, sur l’humanité en tant que telle, a été remarquable, mais il n’a pas conduit à la rédemption du monde, il n’a pas mobilisé les masses. La poésie de Walt Whitman, d’Ezra Pound a échauffé les âmes, créé le doute et la contradiction, mais elle n’a pas été capable de régner sur la société. Dans la poésie hongroise, Endre Ady est le seul poète dont la poésie a allumé de grands feux dans l’âme des gens, mais il n’a pas eu d’effet sur la paix et la justice sociale. L’ère du proète-profète est révolue. Aujourd’hui, les gens lisent très peu de poésie. Non pas parce que la production poétique est faible — je pense d’ailleurs qu’elle se renforce — mais parce que les forces de communication ont changé. Elles influencent l’homme d’aujourd’hui, le rendent aveugle et le dégradent.
Vous êtes le président du PEN Club Hongrois. Que pouvez-vous nous dire sur cette organisation d’écrivains ? Que faites-vous pour la paix ?
Le PEN Club Hongrois a été fondé en 1926, après la Première Guerre mondiale, à l’issue de laquelle la Hongrie a été privée des deux tiers de son territoire et d’un tiers de sa population par les grandes puissances de l’époque — la Grande-Bretagne et la France. Le PEN Club Hongrois a été fondé pour promouvoir la coopération culturelle entre les nations par le biais de la littérature et de la diplomatie culturelle, dans l’esprit du PEN International, fondé en 1921 à l’initiative de l’écrivaine anglaise Catherine Amy Dawson Scott, et pour atténuer l’isolement culturel de la Hongrie, également causé en partie par la guerre. Fort de son expérience à Londres, Gyula Germanus, professeur d’université orientaliste renommé, a été l’initiateur et le principal organisateur du PEN hongrois. Il en est également devenu le premier secrétaire, et son président était le dramaturge, romancier, rédacteur en chef de journal, directeur de théâtre, traducteur littéraire et personnalité publique académique Jenő Rákosi. Le président exécutif était quant à lui Mózes Rubinyi. En 1930, Dezső Kosztolányi, poète, romancier et dramaturge hongrois de renommée mondiale, essayiste et bon ami de Thomas Mann, qui parlait français, anglais, l’allemand et italien, a pris la présidence. Lors du congrès mondial international du PEN Club qui s’est tenu à Budapest en 1931, la France était représentée par Duhamel, Gide, J. Green, Maurois, Romain Rolland, Valéry et Jules Romains. Le PEN Club Hongrois, dont j’ai repris la présidence il y a deux ans à la suite du poète, prosateur et traducteur littéraire Géza Szőcs, décédé tragiquement, a derrière lui près de cent années passionnantes et fascinantes.
Le PEN Club Hongrois a toujours été du côté des combattants de la paix au cours depuis maintenant près de cent ans. Il en va de même aujourd’hui. Nous souhaitons, nous élevons notre voix, pour que les nations du monde ne choisissent pas la guerre et la violence pour régler leurs différends, mais qu’elles suivent la voie de la négociation, de l’accord et de la paix.