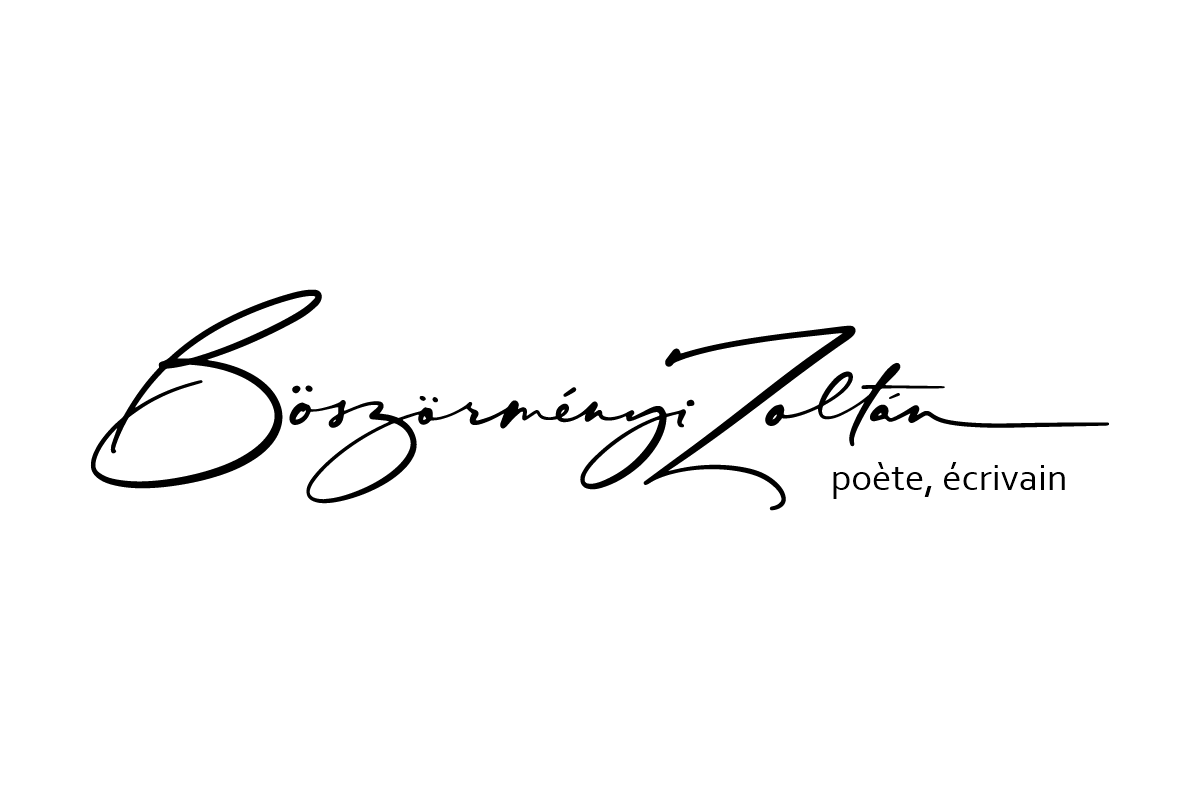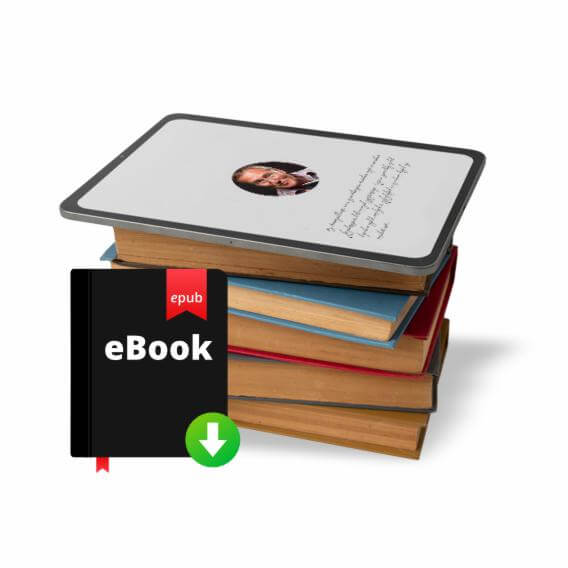Trace de pas
Trace de pas
Mon poème dans le sable de ton âme
N’est qu’une trace de pas qu’un rien disperse,
Sur la pulpe de la trace l’aurore alerte
Sans aucun bruit saupoudre un dernier rêve.
Pur lait que ce matin dans lequel a trempé
Ton corps qui fait cailler tout l’horizon -
Le révolu revient me torturer,
Mais bientôt, bouche lasse, il y renonce.
Espoir : telle est la fleur qui m’empoisonne.
Un chagrin ronge mes années d’existence :
De ton univers, avoir voulu une tranche.
Et cependant que je te dis ce manque,
Sur sa pulpe une aurore maigrichonne
Saupoudre un dernier rêve en grand silence.
Le poeme est partisans lutter pour sa classe
(le poème est parti sans lutter pour sa classe
et il a fait Paris, Dédé l’y a vu (Ady)
et il a fait Moscou dans un désir fugace
de dénicher Pouchkine, rousski poète maudit
cherchant la liberté et cherchant l’amour pur
jusqu’au moment où le jour même devint obscur
éros au creux de l’aine, la musique de ses chers
souvenirs, et sur ses épaules, la ville entière
faisant tinter une chaîne d’acier – la mienne, peut-être,
il s’arrêta au coin : qu’elles étaient blanches, ses lèvres !)
et t’as crié : « debout ! va lutter pour ta classe !
tu t’élèveras en même temps que les masses ! »
seulement voilà, les classes, depuis, sont terminées
quant à moi, élimé jusqu’à la trame du temps
je m’insinuais dans un brouillard dense
hanté par la vanité de tous mes essais
le verbe n’a pas eu, crois-moi, le poing assez puissant
leur pain blanc, depuis lors, ils l’ont mangé
de la bouillie rien n’est resté
ni la moindre goutte de lait
et pourtant les boutiques sont pleines de marchandises
d’un océan de biens
et la moitié du monde, aujourd’hui comme jadis
crève constamment de faim
personne n’a faim de verbe
mais tous aspirent à l’ineffable
au goût de la joie jaillissante
au parfum de la coriandre
au feu, à l’insurrection
au moment, où il n’est plus besoin
de marchander avec quiconque, personne ni rien
n’étant plus obligé au mensonge
se faire face à soi-même
est-ce un regard dans un miroir ?
mais chaque miroir te ment
l’instant accouche du bâtard temps
il ensilote le verbe
qu’il nous reste demain
encore un endroit calme
où pourra hiberner
l’inexistence de l’âme
parle du rien
du brouillard des lambeaux de cet univers-temps
équilibriste sur son fil
contemplateur fervent du bien épais réel
il danse
un pas (ou pas)
ses pas qu’admire, bouche bée
le précipice
les rochers prendront feu
si son regard dévie
parle du rien
Ne reste que l’intention
du ruisseau et de l’herbe
de la peau si fine des après-midi
du rêve palpable
des merveilles éparpillées
du plaisir exalté de l’attente
voici que la morale des arbres devient irréprochable
voici qu’on ne manifeste plus contre le gouvernement
voici que les faucons de guerre trompettent dans notre ciel
et que défile la peur en rangs serrés
un drapeau flotte encore, tout blanc, sur l’acropole
la Chine a acheté nos désirs très bon marché
et les voici en vente, pour quelques centimes, à la bourse du monde
poème
vois-tu l’avenir ?
et à quoi bon te battre pour ta classe
si du verbe semé ne sort qu’étoupe, filasse
si tes joues brûlent des gifles de menteurs
si le sourire du ciel serein n’est qu’un leurre
la voûte de la conscience se couvre de nuages
c’est maintenant crois-tu que tout se départage
et qu’aucun mur n’arrête la marche de l’esprit
les meules de la lumière au ciel s’attrouperaient
l’âme, oh, l’âme, quel honorable cendrier
(voici qu’on t’incrimine, qu’on t’accuse de faiblesse
d’avoir jeté aux chiens l’outil, la flamme, la foi,
l’inspiration, hurlant, pareil au hors-la-loi
sur qui tous les tonnerres s’abattent, et qui s’affaisse)
poème
vois-tu l’avenir ?
sur son espace-lit gît le rien créateur – le rêve s’est perdu
dans la brume, les eaux basses d’une nuit, dont le sang flotte à tes yeux
un varech y ondule sur le sourire des veines, s’y balançant vers toi
prend-le pour t’attacher à ces cieux de jadis et lève tes yeux vers moi
quand bien même le désir diffère ses accessoires, et qu’à la corde
de tes muscles se colle une peur pleine de sagesse, suis-moi sur les cimes
imagine qu’à nouveau tu vas vivre en personne la force du présent
poème
vois-tu ton avenir ?
Cher city-breakers
ici, c’est la place Haydn
il va sans dire qu’elle doit son nom
à ce compositeur qui cependant
n’y a jamais mis les pieds
les édiles, malgré tout, avaient entendu parler de lui, et donc
ils ont décidé
que le nom de la place serait place Haydn
la sonorité du A étant d’une grande noblesse
et tant il est plaisant de l’allonger
pour aussitôt laisser le « y » s’effilocher dans son sillage
et sur ses cinquante mètres carrés – juste
pour dire, cela fait bien moins de lumière solaire
à importer de l’étranger (cette semaine, hélas, le prix
de l’oxygène a doublé), ça demande moins
de cloches de verre au-dessus des fleurs
et pourtant, comme vous voyez, le panorama est tout juste splendide
c’est la fin de la minute à laquelle j’ai droit, merci
pour votre patience et bonne fin de séjour
De grandes fables jaunes
Je fais paître des troupeaux de nerfs,
de grandes fables jaunes : le temps de mon enfance,
le page détale,
la palme d’un drapeau sifflant dans sa main,
avec son flingue pneumatique il joue à proximité de mon cœur.
Comme, devant son cadeau ouvert,
l’hyperactif de deux ans :
c’est ainsi qu’il crée une oasis de sourire,
et que lui succombent les grandes fables jaunes :
le temps de mon enfance,
et mon fouet, il les confisque,
hausse les épaules,
son bâton domestique le troupeau de mes nerfs.
Et partout l’argent
Retire, Virgile, ta cape de pèlerin,
met tes habits de fête ! Assez servi auprès de Dante !
viens t’asseoir avec nous, épions la voûte céleste !
Il se fait tard. L’enfer a déjà fermé ses portes.
Des lévites, déjà, gardent les fentes des murs florentins,
ne laissant pas même entrer la nuit.
Assieds-toi à mon côté, au pied du mur, philosophons :
Le monde a-t-il avancé depuis Aristote,
où n’est-ce que le manège de l’histoire,
partout, la spirale de la répétition ?
Des fenêtres s’ouvrent, virtuelles,
échangeant des clins d’œil.
L’aube pourchasse l’armée vaincue des rêves.
Sur une dalle de lumière, de nouveaux plans se lissent les plumes.
Et partout l’argent.
L’argent sur son trône, les bras croisés,
sur ses lèvres, le sourire méprisant d’un monde virtuel.
(Allons, Virgile, récitons un mantra sanskrit.)
Nous dansons, tous autant que nous sommes, sur le fil du couteau,
on ne remarque que rarement qu’il est trop tard pour ci, pour ça,
les choses passagères, autour de nous, passent,
même les archives, de temps en temps, sont recopiées
selon les goûts du commanditaire. (Cela, je crois
qu’Aristote le savait aussi.)
Comme il ne manquait à personne et ne demandait à personne de mourir pour lui,
le poème n’est pas devenu une grande puissance,
mais juste la douleur absurde de ceux qui courbent sous le souci.
Et partout l’argent.
On ne peut plus faire un pas sans lui.
(L’entendement lance grief après grief.
un tas de rien tournoie dans le changeant alliage existentiel.)
Nous sommes esclaves de la gravitation.
Même ainsi, notre état n’est pas sans espoir : plus personne ne pourra
cacher les secrets de l’univers – ensevelis en nous-mêmes.
Des étés étouffants s’abattent sur nos poitrines,
dans le sauna de l’arbitraire social.
Rendons grâce au Tout-puissant : il nous arrive aussi quelque-chose.
Cela nous arrive, car nous ne perdons pas le fil :
pierre, tablette d’argile, os, soie, papyrus, papier, écran, pierre,
tablette d’argile, os, soie,
soupçon d’une seule cellule.
Le péché est pardonnable. Celui qui a péché n’expiera point.
Hammurabi : aujourd’hui comme hier, dent pour dent.
Pythagore, Thalès, Hippocrate, Archimède.
L’esprit seul ne mesure rien. La position
des étoiles mesure tout.
Virgile, es-tu d’accord ?
Nous épions les dieux que nous avons créés.
Nous épions le dieu unique.
Qu’il ne nous abandonne jamais.
Voilà pourquoi nous le trahissons mille, cent mille fois.
(Ou bon, disons une fois par jour : d’accord ?)
Et partout l’argent.
Des cannibales bien capitalisés.
Pour toile de fond de la morale : des tocsins et des herbes folles.
Il faut sauver les Garçons de la rue Paul !
Et tant pis si à l’Ouest, rien de nouveau pour le poème.
(Et ici c’est pas mieux.)
Suis le pied du vers avec les yeux d’Argus. Tant qu’il aura des pieds,
et que ses chances de survie n’auront pas été bazardées,
comme la Hongrie, il y a cent ans, par ceux qui nous ont précédés.
Bénis le Hongrois, ô Seigneur.
…that goverment of the people, by the people, for the people…*
Nous nous réchauffons au fourneau de l’été.
Qu’importe combien de fois nous le ferons. L’important,
c’est que les autres puissent aussi s’approcher du feu.
Sinon, sur les champs de bataille du quotidien
les congruences se videront de leur sang,
des rêves ataviques resteront collés au grillage de l’obsession,
et nul n’apportera de solution à la solution.
Répétition : sa monotonie, son tragique,
et l’inoubliable qu’on peut oublier.
Pour sûr on escaladerait bien volontiers des monts
plus hauts que celui-ci, ne serait-ce que pour pouvoir le voir.
Car c’est le désir de voir qui, tous, nous a amené ici :
nous voulions voir ce qui rassérène un regard brumeux.**
Et partout l’argent.
* Abraham Lincoln, 19 novembre 1863, dernière phrase du discours de Gettysburg.
** Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.